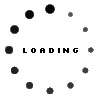Le théâtre japonais
Le théâtre japonais
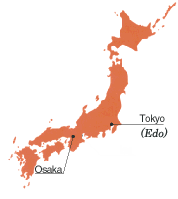
La légende veut que le théâtre japonais provienne d’un spectacle donné par les dieux pour faire sortir Amaterasu, la déesse du soleil, de la grotte où elle s’était réfugiée. Entendant des chants, la déesse sortit de sa cachette et découvrit les autres dieux dansant au milieu de guirlandes de fleurs. Depuis, grâce au théâtre le monde ne peut plus être définitivement plongé dans les ténèbres.
L’art dramatique japonais traditionnel allie le théâtre, la danse et le chant. Il est extrêmement délicat de les différencier, du moins dans leurs formes classiques. On peut cependant déceler l’élément principal de chacune de ses disciplines.
![]() Nô, drame lyrique
Nô, drame lyrique![]() Kyôgen, farce
Kyôgen, farce![]() Kabuki, épique et populaire
Kabuki, épique et populaire![]() Bunraku, théâtre de marionnettes
Bunraku, théâtre de marionnettes
Musique
Hayashikata, chant propre au Nô
Ondo, hymne folklorique local
Le Nô

Le Nô est un des styles traditionnels de théâtre japonais, venant d’une conception religieuse et aristocratique de la vie. Ce sont des drames lyriques au jeu excessivement dépouillé et codifié. La gestuelle des acteurs est stylisée autant que la parole qui semble chantée.
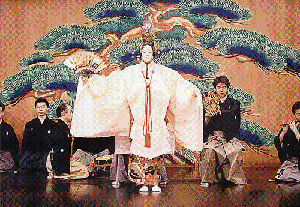
Constitué fin XIIIe siècle au Japon, le Nô est une forme théâtrale unissant deux traditions : les Kagura, ou pantomime dansée, et les chroniques versifiées récitées par des moines errants. Le drame, dont le protagoniste est couvert d’un masque, était joué les jours de fête dans les sanctuaires. Ses acteurs, protégés par les daimyo et les shogun, se transmettent depuis lors de père en fils les secrets de leur art. Le Nô a évolué de diverses manières dans l’art populaire et aristocratique. Il formera aussi la base d’autres formes dramatiques comme le Kabuki. Après que Zeami a fixé les règles du Nô, le répertoire s’est figé vers la fin du XVIe siècle et nous demeure encore intact. Le Nô est unique dans son charme subtil (yûgen) et son utilisation de masques distinctifs.
Ce sont des drames brefs qui dure entre 30 minutes et deux heures. Une journée de Nô est composée de cinq pièces, de catégories différentes. La salle est, en général, assez petite, quelques centaines de places, la plupart du temps sans fauteuils, les spectateurs étant assis sur leurs talons, sur ces nattes souples qui remplacent le plancher dans la maison japonaise. Tout le fond de la salle est occupé par la scène. Celle-ci, en souvenir d’un temps où elle était un édifice indépendant, dressé dans la cour d’un temple, est recouverte d’un toit de style bouddhique. Elle comporte deux parties : le plateau et le pont. Le plateau quadrilatère à peu près nu (excepté le kagami-ita, peinture d’un cèdre au fond de la scène), d’un peu plus de cinq mètres de côté, avance dans la salle, à droite ; sur le côté droit de ce plateau, un étroit balcon sur lequel s’installe le chœur, de quatre, huit ou douze chanteurs ; au fond, le plateau est prolongé par un espace large d’environ deux mètres où sont assis, face au public, les musiciens : de droite à gauche, une flûte, deux tambours à cordes et pour les pièces les plus animées, un « gros tambour » ; peinte sur la cloison du fond, l’image d’un pin antique qui étend ses branches noueuses parfois entrelacées de rameaux de pruniers en fleurs. Le plateau est prolongé, sur la gauche, par le Hashigakarile, une passerelle étroite qui peut avoir jusqu’à quinze mètres de long ; son extrémité est fermée par un rideau qui le sépare des coulisses. Ce principe a été adapté ensuite au Kabuki en Chemin des fleurs (Hanamichi).

Les musiciens entrent en scène les premiers, par le pont ; en même temps arrive le chœur, par une petite porte ménagée au fond à droite. La pièce commence par une ouverture instrumentale destinée à créer l’atmosphère : attaque de la flûte, bientôt accompagnée par les deux tambours. Les joueurs de tambours ponctuent cette musique de cris modulés assez surprenants pour qui les entend pour la première fois.
Puis vient le waki, « celui du coin », l’acteur secondaire, qui restera, à peu près tout le temps que dure la pièce, assis au pied du pilier de droite, sur le devant de la scène : son rôle est celui d’un spectateur, d’un voyant, ou mieux encore, d’un médium, car le shite, « l’acteur », le protagoniste, dont le masque produit un effet de « distanciation » est, le plus souvent, un fantôme, une divinité ou un démon apparaissant au waki. Presque toujours, nous sommes prévenus que le personnage central de la pièce n’est qu’une vision ou un songe de ce dernier. Le waki en effet, qui est généralement un moine, arrive, au cours d’un voyage, en un lieu illustré soit par un combat, soit par un antique roman d’amour, ou bien encore hanté par une divinité ou un démon. Un vieillard ou une jeune femme qu’il rencontre là lui rappelle l’histoire et la légende de ce lieu pour lui révéler enfin qu’il ou elle n’est autre que le spectre du héros ou de l’héroïne, le démon ou la divinité qui hante ces parages. Le shite disparaît alors pour revenir l’instant d’après, en brillant costume et sous ses traits véritables. Puis il évoquera, par une danse, sa vie passée ou les traits de sa nature.

Une représentation complète de nô comprend cinq pièces choisies respectivement dans chacune des cinq grandes catégories entre lesquelles se répartit le répertoire. La pièce « d’ouverture » est une « pièce votive » ou « nô de divinité » Elle prépare le spectateur à ce qui va suivre en le mettant dans un état de réceptivité convenable. La seconde pièce met en scène un guerrier : le spectre d’un guerrier tourmenté par le souvenir de ses fautes, apparaît à un moine devant qui il retrace son dernier combat avant de disparaître, généralement apaisé par les prières du saint personnage. La troisième est une « pièce de femme » : une héroïne des temps passés vient, doux et pitoyable fantôme, implorer le secours du moine afin qu’il l’aide à se détacher des passions qui l’enchaînent encore au souvenir de sa vie terrestre. Puis vient une pièce dite « du monde actuel ». Celle-là contient déjà l’embryon d’un drame et peut comporter une action assez animée, par exemple une scène tirée d’un récit épique ; ou bien c’est l’histoire d’une « folle » : la plupart du temps une mère dont l’esprit est troublé par la disparition de son enfant qu’elle finira par retrouver, à moins qu’elle ne découvre une tombe. Enfin, pour terminer sur un rythme plus rapide, endiablé, un « nô de démon » ; démon que notre moine va exorciser ou – pourquoi pas – convertir, puisque, « par nature, tout être porte en lui la faculté de devenir bouddha ».
Ce rapide survol de cinq pièces dont chacune dure une heure ne permet évidemment pas d’évoquer toute la densité, toute la gravité que recèle un tel spectacle, et encore moins la tension d’esprit qu’il produit chez le spectateur. Celui-ci ne pourrait supporter le spectacle si les cinq nô se suivaient sans interruption ; d’où la nécessité des intermèdes comiques, des kyôgen qui, déclenchant un rire mécanique, viscéral, assurent la détente nerveuse indispensable.
Il y a quatre catégories principales d’acteurs de Nô, et huit catégories principales de rôles:
- Le Shitekata correspond au type de jeu d’acteur le plus représenté. Ces acteurs interprètent divers rôles, dont le Shite (le protagoniste), le Tsure (compagnon du Shite), le Jiutai (Chœur chanté, composé 6 à 8 acteurs), et les Koken (serviteurs de scène).
- L’acteur Wakikata incarne les rôles de Waki, personnage secondaire qui est la contre-partie du Shite.
- Le Kyogenkata est le style de jeu réservé aux acteurs jouant les rôles populaires dans le répertoire Nô et toute la distribution des pièces Kyogen (représentées en intermède entre deux pièces Nô).
- Le style Hayashikata est pour les musiciens qui jouent des quatre instruments utilisés dans le Nô.
Une pièce de Nô implique toutes les catégories d’acteur. Il y a approximativement 250 pièces au répertoire et six catégories de Nô, qui sont classées par sujet:
- 1re catégorie: pièces de dieux.
- 2e catégorie: pièces de guerriers.
- 3e catégorie: pièces de femmes.
- 4e catégorie: pièces de femmes folles.
- 5e catégorie: pièces de démons.
- Okina/Kamiuta: pièce unique alliant danse et rituel Shinto. (La plus ancienne pièce du Nô)
Il y a environ 1500 acteurs professionnels de Nô au Japon aujourd’hui, et cette forme d’art recommence à prospérer. Contrairement au Kabuki qui est toujours resté très populaire, le Nô s’est peu à peu tourné principalement vers une certaine élite intellectuelle. Les cinq familles de Nô sont les écoles Kanze, Hosho, Komparu, Kita, et Kongo. Les familles de Kyogen étant à part.
Les origines
« Item, voici comment débuta le sarugaku au temps des dieux : au moment où la Grande-Divinité-qui-illumine-le-Ciel se confina dans la Céleste-Demeure-Rocheuse, le Monde-sous-le-Ciel fut plongé dans les ténèbres ; lors, les huit cent myriades de dieux s’assemblèrent sur le Céleste-Mont-Kagu, et dans l’intention de captiver le divin Cœur de la Grande-Divinité, ils lui offrirent un kagura et commencèrent un seinô. D’entre eux, Ama-no-uzume-no-mikoto s’avança : [tenant] des bandelettes votives fixées à un rameau de sakaki, élevant la voix, soulevant d’un piétinement rapide un roulement de tonnerre, quand elle fut en état de possession divine, elle chanta et dansa. Comme cette voix divine lui parvenait indistincte, la Grande-Divinité entr’ouvrit la Porte-Rocheuse. La terre, de nouveau, s’éclaira. Les divines faces des dieux resplendirent. Le divin divertissement de ce temps-là fut, dit-on, le premier des sarugaku.
Item, dans la patrie du Bouddha, quand le riche-homme Shudatsu eut édifié le monastère de Gion, au moment de la dédicace [de celui-ci], alors que le Shaka-nyorai était en train d’expliquer la Loi, Daiba, suivi d’une myriade d’hétérodoxes [tenant] des bandelettes votives fixées à des branches d’arbre et des feuilles de bambou, dansait et chantait à tue-tête, de telle sorte que la prédication devenait impossible ; lors le Bouddha lança un coup d’œil à Sharihotsu, et celui-ci, pénétré de la puissance du Bouddha, alla disposer dans la pièce du fond tambours et gongs et, mettant à contribution le génie d’Anan, la sagesse de Sharihotsu et l’éloquence de Furuna, il fit exécuter soixante-six mimes ; lors les hétérodoxes, oyant le son des flûtes et des tambours, se groupèrent au fond, et à ce spectacle, furent calmés. Profitant de ce répit, le Nyorai prononça sa prédication. C’est de là que date, dans l’Inde, le commencement de notre voie.
Item, au Japon, sous le règne de Kimmei-tennô, sur la rivière Hatsuse, dans la province de Yamato, à l’occasion d’une crue, une jarre venue de l’amont descendit le courant. Du côté du torii cryptomère de Miwa, un courtisan recueillit cette jarre. Dedans, il y avait un enfançon. Ses traits étaient charmants. Il était pareil à un joyau. Puisqu’il s’agissait d’un être descendu du ciel, on rendit compte au Palais. Cette nuit-là, dans un songe de l’Empereur l’enfançon déclara : « Moi que voici, je suis la réincarnation du Premier-Souverain du Grand Empire Shin. Ayant avec les Régions-du-Soleil des liens de karma, à présent, je m’y suis manifesté ». L’Empereur, estimant qu’il y avait là un prodige, le fit mander au Palais. A mesure qu’il croissait en âge, il dépassait quiconque en sagacité, de sorte qu’à quinze ans, il s’était élevé au rang de ministre, et l’Empereur lui conféra le nom de Shin. Or, le caractère shin se lit hata, et voilà pourquoi il se nomma Hata no Kôkatsu. Jôgu-taishi, à un moment où l’Empire connaissait quelques troubles, se référant aux précédents fastes de l’âge des dieux et de la patrie de Bouddha, commanda soixante-six mimes à ce Kôkatsu ; par la même occasion, il sculpta de sa propre main les masques pour les soixante-six mimes, et il voulut bien les confier à Kôkatsu. On présenta [ces mimes] au Pavillon-des-audiences du Palais de Tachibana… On appela [ces mimes] sarugaku… Kôkatsu transmit son art à ses descendants.»
(De la transmission de la fleur de l’interprétation, Livre IV).
C’est en ces termes que Zeami, dans ses traités secrets de l’art du sarugaku-no-nô, évoque la triple origine, japonaise, bouddhique (c’est-à-dire indienne) et chinoise, de son art qui devait devenir le nô, le premier des trois genres classiques du théâtre japonais. Nous retrouvons continuellement des traces de ces trois éléments, auxquels vient s’ajouter, pour le théâtre moderne, l’influence occidentale.
En cinq siècles, le nô n’a guère évolué, mais son mouvement s’est ralenti. On a pu établir, en effet, que la même pièce, jouée aujourd’hui, dure presque deux fois plus longtemps qu’autrefois. C’est à cette particularité qu’est dû ce qui apparaît aujourd’hui au profane comme le caractère distinctif de ce théâtre, à savoir sa lenteur et sa dignité hiératique. Et c’est ainsi qu’il est devenu cet art de musée que de pieux conservateurs entretiennent avec componction devant un public restreint de fidèles confits en dévotion.
Il n’en reste pas moins que le nô est aujourd’hui encore un spectacle d’intérêt, et qu’il provoque chez le spectateur, du moins lorsqu’il est bien interprété, un état d’esprit voisin de celui que Zeami entendait susciter. Sa densité esthétique est telle qu’un programme de cinq nô serait insupportable sans les intermèdes comiques, les farces appelées kyôgen que, très tôt, on avait pris l’habitude d’intercaler entre deux nô successifs. Le ressort comique est souvent grossier. Il s’agit avant tout de provoquer une détente nerveuse par un rire franc et sans arrière-pensée. Les têtes de turc du kyôgen sont essentiellement les mêmes que celles de nos fabliaux : la femme, le seigneur, le curé (ici le desservant d’un temple bouddhique), le valet sot ou fripon.
Quelques rares kyôgen s’élèvent presque au niveau de la comédie de mœurs, et l’on pourrait les rapprocher des premières comédies de Molière encore très proches de la farce pure : Sganarelle ou Scapin sont des personnages de kyôgen. Les kyôgen contribueront, au XVIIe siècle, à la formation d’un théâtre d’action aux antipodes du nô, le kabuki.

Le Kyôgen ou l’art du grotesque

Nô et kyôgen constituent un couple improbable, sinon infernal : ils ont beau n’avoir pratiquement rien en commun, ils sont absolument inséparables. C’est qu’il faut bien que l’acteur de nô change de costume, de masque et de coiffure entre la première et la seconde partie de la pièce. Aussitôt, l’humble acteur de kyôgen, qui appartient à une corporation distincte et longtemps jugée inférieure, lui sert de bouche-trou, profitant de la tirade qui lui est alors impartie pour paraphraser dans la langue des gens du commun les récits hautement littéraires que les acteurs et le choeur tragiques ont préalablement psalmodiés. Dès le XVe siècle, l’usage s’était instauré d’intercaler entre deux pièces sérieuses un épisode comique de Sarugaku (danse du singe). Sous le nom de Kyôgen, paroles folles, ces farces deviendront inséparables du Nô. En effet, si le Nô exprime ce que nous voudrions être, la voie de nos aspirations, le Kyôgen exprime ce que nous sommes et son acceptation: deux chemins conduisant à la sagesse.

Et que serait sans les farces de kyôgen la journée traditionnelle de nô, sinon une interminable déploration ? Le personnage de kyôgen est bon vivant, roublard, buveur invétéré et prêt à tout pour étancher sa soif, il renvoie le spectateur à sa dérisoire et touchante humanité quand le nô le transporte hors de lui-même. Les saynètes de kyôgen, intercalées entre chacun des cinq nôs traditionnels, assurent le mélange des genres et rompent la monotonie, fût-elle majestueuse. Ce sont des farces au sens littéral du terme, puisqu’elles farcissent la journée de spectacle. Le Kyôgen joue donc, en tant qu’intermède de vingt à trente minutes, le rôle de contrepoint face à la tension tragique du Nô. Bouffonneries inspirées de la vie quotidienne médiévale, les pièces de Kyôgen plongent à la manière de la commedia dell’arte dans la satire sociale. Elles sont confiées depuis la nuit des temps, ou du moins depuis l’époque Muromachi (XIVe et XVe siècles), à un petit nombre de familles qui en ont transmis la tradition : imaginons un instant La Farce de Maître Pathelin (chef d’oeuvre du théâtre comique médiéval) jouée par les successeurs en ligne directe de ses créateurs !

Il est joué la plupart du temps sans masque, avec peu de musique et de chœur, il utilise la langue de l’époque (à l’inverse du Nô qui cultive les archaïsmes) et, toujours par effet de contraste avec le Nô, évite le surnaturel sauf pour le parodier, et surtout les personnages nobles. Bien qu’ayant un répertoire fixe et des techniques d’une grande rigueur, le Kyôgen garde à l’esprit qu’il vient d’un art de l’improvisation, ce qui est confirmé par l’importance des variantes et versions entre les répertoires des écoles.
Il existe deux écoles, l’école Okura (la famille Shigeyama en est la plus célèbre représentante) et l’école Izumi (la famille Nomura en est la plus célèbre représentante). Avec 177 pièces en commun, les répertoires comptent 180 pièces pour Okura et 254 pour Izumi.
Le répertoire actuel compte environ 300 pièces. Le Kyôgen se joue le plus souvent à visage découvert, (mais le masque est parfois utilisé, notamment dans les parodies du Nô, ou lorsque des personnages fantastiques ou surnaturels sont en jeu). Contrairement au Kabuki, les costumes et les lumières sont ici volontairement très sobres afin de porter toute l’attention du spectateur sur l’interprétation du comédien. L’un des plus célèbres acteurs de Kyôgen fut Shimé Shigeyama.
Le Kabuki

L’apogée du théâtre de poupées coïncide avec la période de production intensive de Chikamatsu Monzaemon et de ses successeurs immédiats. Cependant, dès les environs de 1750, le public commençait à déserter les salles au profit d’un spectacle plus ancien que le Ningyô-jôruri (Bunraku), mais qui était resté jusque là très vulgaire et plutôt méprisé : le kabuki.

Les historiens du théâtre japonais datent généralement la naissance du kabuki de l’année 1605. Une danseuse du temple d’Izumo, O.Kuni, était venue s’installer à Kyôto où elle présentait, sur des tréteaux improvisés, des nembutsu-odori, danses d’origine bouddhique. Bientôt, elle groupa autour d’elle une troupe féminine, à laquelle vinrent se joindre des acteurs de kyôgen sans emploi. Aux danses proprement dites, on ajouta des farces. Ce fut ce que l’on appela le kabuki d’O.Kuni, du nom de sa fondatrice. Le mot kabuki fut transcrit par la suite au moyen de caractères signifiant « art du chant et de la danse », mais en réalité, ce terme semble avoir une origine plus prosaïque dans le verbe kabuku, « se contorsionner ». Il n’y avait encore là rien de bien différent des saltimbanques du Moyen Âge.
La troupe d’O.Kuni avait conservé une certaine tenue ; il n’en fut pas de même de ses imitatrices, des troupes de femmes dont la fonction essentielle était d’attirer des clients dans les maisons de prostitution. Le scandale fut tel que, dès 1630, le gouvernement interdit aux femmes de monter sur la scène. On les remplaça donc par des jeunes gens, mais le scandale fut pire encore. D’où une nouvelle interdiction en 1652.
Paradoxalement, ce furent ces interdictions répétées qui valurent finalement au kabuki ses traits caractéristiques et son évolution vers un type de théâtre classique. En effet, si le kabuki d’avant 1652 consistait essentiellement en danses érotiques, après l’intervention des autorités, on en vint à interpréter des danses d’un caractère plus sérieux, ainsi que des scènes de théâtre parlé, inspirées des kyôgen. Cependant le kabuki, toujours interdit aux femmes et aux éphèbes, confiait à des acteurs spécialisés l’interprétation des rôles féminins. Cet usage, toujours en vigueur, devait marquer fortement les « danses de femmes ». La force physique des acteurs permettait de leur imposer des efforts qui eussent été exténuants pour une femme. À tel point qu’il est impossible aujourd’hui, même aux meilleures danseuses, d’interpréter correctement ces danses.
La région d’Osaka ne permettait pas au kabuki de se développer librement en raison de la vogue du théâtre de poupées. Les meilleurs acteurs de kabuki émigrèrent donc vers Edo, où, dès les premières années du XVIIIe siècle, ils mirent au point une forme de théâtre nouvelle. Le public d’Edo était toutefois, à cette époque, moins raffiné que celui des environs de la capitale, et les spectacles s’en ressentaient. D’où la formation d’une première manière que l’on a très justement qualifiée de réalisme grossier allié à un romantisme forcené. L’un des fondateurs du kabuki d’Edo créa un genre connu sous le nom de aragoto ou « manière rude ».
Le kabuki en était là, lorsque l’on eut l’idée d’exploiter la popularité du théâtre de poupées en lui empruntant son répertoire. Le succès fut presque immédiat. Le public, évidemment las des marionnettes, accueillit avec enthousiasme l’interprétation, par des acteurs en chair et en os, de pièces qu’il connaissait bien. Au départ, les acteurs du kabuki s’efforcèrent d’imiter servilement le jeu des poupées. Ils conservèrent les récitants qui commentaient l’histoire sur le mode gidayu, et poussèrent, dans certains cas, le souci de l’imitation, jusqu’à adjoindre aux danseurs des pseudo-animateurs vêtus de noir. Tandis que les animateurs de marionnettes cherchaient à reproduire la souplesse de la vie, les acteurs de kabuki tentaient de donner à leurs mouvements la raideur des poupées. Ce premier stade, parodique, fut d’ailleurs très rapidement dépassé, lorsqu’on s’aperçut que le public préférait un jeu plus naturel. Le kabuki avait désormais trouvé sa voie. Le kabuki s’enrichit prodigieusement au cours des deux siècles suivants pour prendre peu à peu sa forme actuelle puisque les auteurs dramatiques déserteront les marionnettes pour se consacrer entièrement au nouveau théâtre. Les plus importants sont Tsuruya Namboku et Kawatake Shinshichi, plus connu sous son pseudonyme de Mokuami (1816-1893).

Ce dernier est, sans doute, après Zeami et Chikamatsu, le plus grand auteur dramatique du Japon, le seul dramaturge authentique, en tout cas, qui ait exclusivement travaillé pour le kabuki. Mokuami est, au meilleur sens du terme, un novateur et un moderne. Un novateur, car il a donné au kabuki un répertoire de théâtre au sens occidental du terme, d’un théâtre narratif, qui comporte une action et non plus seulement un thème, des pièces destinées à des acteurs, et non plus adapté, tant bien que mal, du répertoire des marionnettes.
Dès la fin du XVIIIe siècle, le kabuki était devenu un art complet qui exigeait de ses acteurs un entraînement rigoureux et les talents les plus divers. Danse, musique et chant y ont conservé une place prépondérante. Un programme de kabuki comporte presque obligatoirement un morceau de chorégraphie qui est souvent une « danse de femme ». Le danseur-étoile y apparaît tantôt seul, tantôt entouré d’un imposant corps de ballet, tandis que, rangés au fond de la scène sur une estrade, trente ou quarante musiciens et chanteurs assurent l’accompagnement. Cet orchestre comporte essentiellement un certain nombre de shamisen dont la musique est rythmée par les instruments déjà connus du nô : flûte et tambours. Le chant est dérivé du jôruri, soit directement, soit par l’intermédiaire du gidayu.
Les acteurs de Kabuki sont maquillés (et non masqués comme dans le Nô). Les maquillages sont très stylisés, et permettent au spectateur de reconnaître au premier coup d’œil les traits principaux du caractère du personnage.

La danse est également représentée dans les pièces de théâtre proprement dites, soit intégrée à l’action lorsqu’un personnage de la pièce, une courtisane par exemple, le permet, soit à titre d’intermède, sérieux ou comique. Les intermèdes burlesques remontent par-delà le kabuki de la première époque, aux acrobates du sarugaku (saltimbanques). Ce sont des ballets acrobatiques, comparables à ceux que nous présenta naguère l’Opéra de Pékin. Leur mouvement diffère cependant fondamentalement de la manière chinoise, se rattachant plutôt à celle du kyôgen par une stylisation qui a pour résultat une intense puissance comique : l’on y voit des personnages impassibles, coincés dans des costumes lourds et encombrants, se détendrent brusquement en un saut périlleux en arrière pour reprendre immédiatement leur attitude compassée. Lorsque quinze ou vingt danseurs exécutent simultanément ce numéro, l’effet en est irrésistible : tels sont, en particulier, certains combats parodiques, où l’on voit le héros se débarrasser d’un geste d’une troupe de guignols.

Le répertoire est divisé en trois catégories:
Jidai mono (pièces historiques)
Sewa mono (pièces du quotidien)
Shosagoto (morceaux de danse)
Le plupart des pièces toutefois mettent en scène des samouraïs.
Les caractéristiques principales du Kabuki sont l’Onnagata, le Mie (moment où l’acteur se fige un instant dans une attitude caractéristique du personnage), et le Hanamichi (littéralement chemin des fleurs), pont permettant aux acteurs d’entrer en scène en traversant le public.
À ce répertoire déjà abondant, vinrent s’ajouter, au cours du XIXe siècle surtout, de nombreuses pièces de théâtre parlé, d’où la musique est à peu près complètement exclue. Cette veine est loin d’être tarie : chaque mois, les théâtres de Tôkyô ou d’Osaka présentent des pièces de nouveau kabuki d’auteurs contemporains, en même temps que des danses nouvelles de style classique, où l’influence européenne se fait à peine sentir. Cela pour dire que le kabuki est tout autre chose qu’un conservatoire, qu’il s’agit d’un théâtre qui, tout en perpétuant un art classique, reste vivant et se renouvelle perpétuellement.

Le Ningyô-Jôruri ou théâtre de poupée (Bunraku)


Le Ningyô-jôruri ou Bunraku, qui tire son nom d’une salle (bunraku-za – elle fut ainsi nommée en hommage à Uemura Bunrakuken, chanteur au XVIIIe siècle de jôruri (drame récité) ouverte à Osaka en 1872 et qui depuis est la seule à présenter exclusivement ce genre théâtral, est apparu à Osaka au XVIIe siècle, créé par un chanteur de jôruri nommé Gidayu. Cet art est le descendant direct de marionnettes à fils, qu’on suppose d’origine coréenne et qu’utilisaient au XVe siècle des moines bouddhistes nomades, pour leur propagande religieuse, mais qui, sous la pression populaire, durent adapter et improviser des histoires plus profanes. Cette forme artistique de renommée mondiale est une combinaison de plusieurs disciplines : la manipulation des poupées, l’art de conter (jôruri), et la guitare japonaise (shamisen – instrument à long manche et à trois cordes).
Une pièce de jôruri apparaît en fait comme un long récit dans lequel s’intègrent les dialogues. Ces récits, déclamés, sont coupés par endroits de scènes lyriques, longs poèmes chantés par plusieurs interprètes, accompagnés au shamisen, ou plus rarement au koto, cithare à 13, 17 ou 19 cordes, ou au kokyû, instrument analogue au shamisen, mais pour lequel on se sert d’un archet. Mis à part ces interludes qui sont, en général, des « chants de route », lorsque les héros de la pièce partent en voyage, ou encore des intermèdes dansés par une ou plusieurs poupées, lorsque leur personnage s’y prête, tout le texte est interprété par un seul récitant à la fois. Ce récitant est relayé après une demi-heure à peu près, car son rôle est exténuant. Assis sur une étroite plate-forme qui prolonge la scène sur la droite et vers la salle, soutenu par un shamisen qui ponctue sa déclamation, il annonce le sujet, évoque le décor, décrit les personnages qui apparaissent, comme évoqués par sa voie, et enfin les fait parler. Cette voix alors se fait multiple, passant sans transition du registre grave et solennel du père noble à l’ironie ricanante du traître, en passant par les inflexions maniérées de la jeune première ou le timbre flûté d’une fillette.

Le Bunraku est donc composé récitants qui chantent tous les rôles (le récitant est appelé tayû), et de trois manipulateurs pour chaque marionnette. Les marionnettistes sont à vue du public et utilisent soit la gestuelle furi, plutôt réaliste, soit la gestuelle kata, empreinte de stylisation, selon l’émotion recherchée. Les marionnettes du Bunraku mesurent entre 70 et 90 cm de hauteur. La tête est en bois et creuse. Elle contient des mécanismes servant à faire bouger les yeux, les sourcils, la bouche et dans certains cas, comme dans la poupée de Gabu, séparer le visage en deux pour faire apparaître une face de démon. Cette tête est posée sur une espèce de croix en bois où sont fixés les bras et les jambes, le tout recouvert par de superbes kimonos superposés. De cette croix partent des cordelettes et des ressorts qui commandent aux poignets de pivoter, aux doigts de bouger ou aux phalanges de saisir un sabre. La manipulation de ces poupées nécessite un maître marionnettiste et deux assistants. Les manipulateurs respectent une hiérarchie réglée en fonction de leur degré de connaissance dans l’art du Bunraku : le maître (omozukai – 20 ans de métier), au visage découvert, passe le bras gauche dans la poupée pour contrôler la tête et son bras droit dans la manche droite. Un assistant contrôle le bras gauche et l’autre (le novice) les pieds. Ces deux assistants sont de noir vêtus et cagoulés. Le geste juste exige une synchronisation parfaite. Afin de manipuler plus aisément la marionnette, les manupilateurs se déplacent en position de Kathakli (jambes demi-pliées), ils doivent ainsi faire beaucoup d’exercices physiques et d’assouplissement afin d’être le plus agile possible. Pour les rôles féminins, les marionnettes n’ont pas de pieds ni de mains, les gestes sont ponctués par les mouvements esthétiques de kimono.

Ces poupées s’animaient, à l’origine, sur un simple tréteau sans décors, mais au XVIIIe siècle, sous l’influence du kabuki qui s’était emparé d’une partie de leur répertoire, des décors de plus en plus complexes, de plus en plus somptueux, firent leur apparition. Ces décors sont généralement peints sur de grandes toiles qui descendent des cintres, ce qui permet des changements rapides, aussi rapides que les changements de costume des petits acteurs dont il suffit de transporter la tête sur un autre vêtement apporté tout monté par un aide. Toutes les opérations autres que l’échange d’un décor entier, sont masquées par une cloison dressée sur le devant de la scène à hauteur de ceinture.
La forme spectaculaire du bunraku s’est développée devant le succès grandissant au siècle dernier du kabuki. Ces deux théâtres ont en commun un même répertoire de pièces historiques et de drames bourgeois. Le théâtre Bunraku relate plusieurs histoire pour la plupart dramatiques, dont le répertoire est tiré de l’immense roman de la littérature orale « Histoire en 12 parties de la demoiselle Jôruri » et du théâtre Kabuki. Depuis le XVIIIe siècle, ce théâtre est réservé à une élite cultivée. L’un des plus grands auteurs pour le Bunraku fut Chikamatsu.
Glossaire
Chikamatsu (1653 – 1724)
Dramaturge, né à Kyoto dans une famille de samouraïs, Chikamatsu Monzaemon est l’un des auteurs les plus connus du Japon et le plus grand dramaturge japonais de tous les temps. Comparé souvent à Shakespeare, il écrit des chefs-d’oeuvre pour les artistes de bunraku et de kabuki et innove en introduisant sur la scène, des marionnettes, les drames urbains et bourgeois ainsi que la représentation de la vie quotidienne. Sa célèbre pièce, Sonezaki Shinju (« Double suicide à Sonezaki »), illustre par une histoire d’amour contrarié le souffle nouveau que Chikamatsu donne au répertoire du théâtre de marionnettes. Pour donner une idée de la popularité de ces représentations, en 1715, Kokuseya-kassen, drame historique de Chikamatsu, interprété par Seidayu, tint l’affiche pendant dix-sept mois.
Daimyo (littéralement « grand nom ») désigne un seigneur féodal japonais.
À l’origine, il s’agissait de samurai des communautés rurales qui, durant les guerres de Ônin (fin XVe siècle), en devenant leaders de groupes armés, s’autoproclamaient daimyo. À ce moment de l’histoire, ils n’avaient que peu de pouvoirs. Mais, par la suite, ils se libérèrent de l’emprise du bakufu (le gouvernement militaire au Japon depuis la fin du 12ème siècle jusqu’à la révolution de l’ère Meiji (1868) et devinrent de puissants seigneurs provinciaux.
Périodiquement (chaque année), un daimyo se devait d’aller rendre hommage à son shogun à Edo: c’est le Daimyo-Gyoretsu.
Époque Muromachi
La période Muromachi s’étend de l’an 1333 à l’an 1576. L’empereur Go-Daigo est renversé en 1336 par Ashikaga Takauji, son allié lors de la guerre contre le shôgunat de Kamakura. Takauji, utilise alors un empereur rival (il y avait quelques dissensions pour savoir qui méritait réellement le titre impérial) comme marionnette et établi un nouveau shôgunat dans le quartier de Muromachi à Kyoto. Le problème de la succession impériale n’est cependant pas réglé et plusieurs décennies de guerre entre partisans de la cour du Nord et de la cour du Sud (les cours des deux prétendants au titre impérial) ravagent le pays. Finalement le troisième shôgun Ashikaga (1358-1408) réussit à donner une certaine puissance au shôgunat. Plus tard cependant les shôguns Ashikaga ont moins de succès pour contrôler leur coalition et le pays bascule dans l’anarchie avec la guerre d’Onin (1467-1477). Après la guerre d’Onin vient la période (une sous-période de la période Muromachi) Sengoku (1467-1568), connue sous le nom de « période des états en guerre ». Chaque partie du Japon est alors indépendant des autres et tout le monde se guerroie parmi.
L’Onnagata ou Oyama est un type de personnage du théâtre japonais.
« Onnagata » littéralement « forme féminine » est le terme désignant un homme qui interprète un rôle féminin pour exprimer de manière stylisée le cœur de la femme.
Technique conçue au milieu du XVIIe siècle par Ukon Genzaemon pour respecter l’interdiction imposée aux femmes de monter sur scène, il donna naissance à différents archétypes de caractères encore très vivants aujourd’hui. Souvent utilisé pour des acteurs de théâtre Kabuki et de danse classique japonaise, il peut aussi être appliqué à des acteurs du théâtre Nô et du Kyôgen.
Un acteur onnagata stylise la féminité de telle manière que son physique réel n’a plus d’importance dans l’interprétation de ses rôles. Seule la théâtralité compte. Ainsi un Trésor National Vivant comme Jakuemon peut-il encore incarner des personnages de jeunes filles à plus de quatre-vints ans. Le plus célèbre Onnagata contemporain est certainement Tamasaburo qui a au Japon une renommée comparable à nos plus grandes stars de cinéma. Cette recherche sur la féminité n’a pas son équivalent en occident.
Sarugaku
Attraction fréquemment jouée durant le moyen âge au Japon. Initialement appelé « Sangaku » elle vient de Chine durant la période Nara et inclus les acrobaties, la jonglerie, l’illusionnisme et le pantomime. Puis il a fusionné avec un théâtre rural japonais « Dengaku » et évolua en drame tandis que les éléments acrobatiques ont été abandonnés durant les périodes Kamakura et Muromachi. La partie sérieuse basée sur la musique devient « No » tandis que le comique, « Kyogen » à la fin de la période Muromachi
Shamisen
Instrument de musique importé de Chine via Okinawa. Son corps forme une sorte de tambour et la peau de chat est étendue dessus tandis qu’une baguette de 1 mètre est attachée perpendiculairement sur le côté avec 3 cordes. Il est joué en le grattant. La région où il est le plus joué maintenant est Tsugaru à l’ouest du département d’Aomuri.
(Photo Shamisen: Sugawara Chiyoshi)

Shime Shigeyama

Célèbre acteur de Kyôgen, Shimé Shigeyama est né à Kyoto le 30 août 1947. En 1976, il crée l’association « Hanagata », qui non seulement contribue très activement à la culture du répertoire et à la redécouverte de pièces tombées dans l’oubli, mais poursuit son travail de création avec la mise au point de nouvelles pièces de Kyôgen. Ayant lui-même débuté à l’âge de quatre ans, il dirige également une école qui enseigne le Kyôgen aux enfants. En 1992, il devient à l’âge de 45 ans «Important bien culturel vivant », puis reçoit l’année suivante le prix de la ville de Tokyo pour l’ensemble de ses travaux. En 1995, il reprend le nom de son père et devient Shimé de la 2ème génération. Depuis le milieu des années 80, il poursuit dans le monde entier une activité très importante, notamment aux Etats-Unis où il séjourne régulièrement. Il est invité en France en novembre 1997 par le Festival d’Automne à Paris. Shimé Shigeyama joue ainsi un rôle très important dans la diffusion du Kyôgen en Occident.
Shinto – Shintoïsme
Le shintoïsme (shinto, littéralement la voie du divin) est la religion d’origine du Japon. Il s’agit d’une religion animiste et polythéiste. Certains dieux (kami) ont une portée locale et peuvent être considérés comme des esprits ou des génies, mais d’autres sont des symboles des éléments naturels majeurs, comme par exemple Amaterasu, la déesse solaire.
Les premiers écrits relatifs au shintoïsme sont le Kojiki (712) et le Nihonshoki (720), compilations de mythes et légendes. À travers eux, la lignée impériale est déclarée descendance directe de la déesse Amaterasu, qui lui a donné mandat pour gouverner le Japon. Leur rédaction coïncide avec l’apparition du bouddhisme sur l’île, tout simplement parce que l’écriture n’était pas connue des Japonais jusque là.
Avec l’arrivée du bouddhisme, les kamis ont été assimilés à des êtres surnaturels soumis au cycle de vie, mort et réincarnation. Kukai, au contraire, voit les kamis comme une manifestation directs des bouddhas.
Durant la période Edo, différentes tentatives ont lieu pour séparer le shintoïsme « originel » de ses influences étrangères comme le bouddhisme et le taoïsme. Lors de la restauration Meiji, le shintoïsme est promu au rang de religion d’État, et les autres religions sont persécutées, voire interdites.
Après la capitulation japonaise de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Empereur renonce officiellement au mythe de la descendance divine. Aujourd’hui, de nombreux Japonais embrassent plusieurs religions, par exemple vouant un culte aux kamis ancestraux, se mariant dans une église chrétienne et se faisant inhumer selon les rites bouddhistes.
Shogun
Le terme shogun signifie «grand général», c’est la contraction de seiitaishougun, qui veut dire «le grand général qui triomphe des sauvages». Néanmoins, après qu’il fut attribué à Minamoto Yoritomo, il devint un titre héréditaire de la lignée Minamoto, indiquant le dirigeant de facto du Japon (dictateur militaire), alors même que l’empereur restait le dirigeant de jure (en quelques sortes le gardien des traditions).
Zeami (1363 – † 1443)
De son nom d’origine Kanze Motokiyo, acteur et dramaturge japonais, il fut le théoricien du Nô. Fils de Kan’ami Kiyotsugu, acteur et directeur d’une troupe près de Nara, Zeami est remarqué à l’âge de 13 ans lors d’une représentation, par le Shogun qui en fait son protégé. Pendant toute sa vie d’artiste, il s’efforça de clarifier et codifier le Sarugaku no nô, alors emprunt de danses populaires, en un art d’esthétisme et de raffinement.
Il a énoncé tous les grands principes du Nô tel qu’on le joue encore aujourd’hui, il en a défini les secrets par des conseils savants et délicats. Sous sa direction, apparaissent l’ensemble des composantes de cet art : costumes, masques, musique, gestuelle codifiée. Il composa près de 90 pièces de théâtre, parmi les plus célèbres : Hagoromo, Shunkan, Takasago. Ses traités demeurent une référence. Après avoir été transmis de pères en fils par les dynasties d’acteurs traditionnels, ils ne furent découverts par le public qu’en 1909. Fûshi kaden (La transmission de la fleur artistique) est sans doute son ouvrage le plus respecté. Il y expose la manière de faire fleurir l’interprétation d’un personnage. Dans ce livre, écrit en exil, il fait ainsi référence au concept de Yûgen (le charme subtil) comme base de son enseignement théâtral.
En 1422, à 59 ans, Zeami se détache du monde flottant pour entrer en religion. Sa succession est transmise à ses fils qui malheureusement disparaissent prématurément, puis à son gendre, Komparu Zenchiku, qui reprend ses enseignements et les fait perdurer. Aujourd’hui encore, les pièces de Zeami sont les plus jouées dans le répertoire du théâtre Nô.
Un merci tout spécial à Marc Pichette et Yuko Kaida
Sources
Wikipedia
http://www.eurasie.net
http://kabuki.ifrance.com/kabuki/
http://www.indiana.edu/~japan/kabuki.html
http://www.encyclopedie-enligne.com
http://www.nihon-fr.com/
Extrait de « Le Théâtre japonais », in Les Théâtres d’Asie, dir. Jean JACQUOT, CNRS, Paris, 1968
et d’autres, voir les liens en bas des différentes pages.
Sources images
www.osamurai.hpg.ig.com.br/ no.htm.
japan-hotelguide.com/ guide/intro/
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/kg_plays/kg_plays03.html
Merci aussi à la traduction japonais-français du site http://www.docoja.com