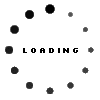Entre soi et le monde : compte-rendu du livre «Carole Fréchette, dramaturge. Un théâtre sur le qui-vive»

Paru aux Éditions Nota bene, l’ouvrage collectif Carole Fréchette, dramaturge. Un théâtre sur le qui-vive constitue une contribution nécessaire à la fois sur l’écrivaine, mais aussi pour le théâtre québécois des 40 dernières années.
Dirigé par Gilbert David, un exégète du théâtre québécois, le livre compte sur près d’une vingtaine de collaboratrices et collaborateurs d’ici et d’ailleurs, dont notre collègue Sara Thibault, Lucie Robert et Louise H. Forsyth, sans oublier un texte de Carole Fréchette elle-même.
 L’expression «nul n’est prophète en son pays» reste encore très actuelle lorsque nous comparons les très nombreuses exécutions scéniques de pièces du répertoire fréchettien à travers le monde à celles venant du Québec (et jamais de reprises «sur des grands plateaux», comme le déplore Gilbert David). Dans sa présentation, ce dernier n’hésite pas à qualifier l’écriture de Carole Fréchette d’ontologique pour parler d’un théâtre «de la comparution» unique et singulier dans la dramaturgie québécoise. Il inscrit cette voix dans la lignée de Jovette Marchessault, Pol Pelletier, Michel Garneau, Normand Chaurette et Lise Vaillancourt.
L’expression «nul n’est prophète en son pays» reste encore très actuelle lorsque nous comparons les très nombreuses exécutions scéniques de pièces du répertoire fréchettien à travers le monde à celles venant du Québec (et jamais de reprises «sur des grands plateaux», comme le déplore Gilbert David). Dans sa présentation, ce dernier n’hésite pas à qualifier l’écriture de Carole Fréchette d’ontologique pour parler d’un théâtre «de la comparution» unique et singulier dans la dramaturgie québécoise. Il inscrit cette voix dans la lignée de Jovette Marchessault, Pol Pelletier, Michel Garneau, Normand Chaurette et Lise Vaillancourt.
En préface, Madeleine Monette, écrivaine québécoise exilée à New York, témoigne, dans Sans coupe-feu, de son amitié à Carole Fréchette (pour qui aucune opposition n’existe entre l’artiste et la femme), qu’elle a connue au Collège Saint-Ignace avant son entrée à L’École nationale de théâtre à l’automne 1970. Elle louange l’évolution de son écriture depuis l’époque engagée du Théâtre des cuisines à aujourd’hui. Si le militantisme «pur» semble avoir diminué, les revendications sociales n’en seraient, elles, que plus ferventes.
Sylvain Lavoie explore la première époque de l’artiste au Théâtre des cuisines (une compagnie toujours active d’ailleurs) entre 1973 et 1981. Le collectif s’inspirait des idéologies marxistes et féministes (malgré les dualités entre les deux) dominantes au début des années 1970. De la pression qu’elle a parfois subie dans ce groupe, Carole Fréchette en aurait toutefois gardé le sens des responsabilités. Précurseur d’une certaine façon du théâtre féministe des années subséquentes (La Nef des sorcières, Les Fées ont soif, le Théâtre Expérimental des Femmes), le Théâtre des cuisines (nom choisi en réaction à une éphémère troupe d’agit-prop de l’époque, Le Théâtre d’la shop) tenait un discours plus politique, près du Front de libération des femmes (1969-1971) et du Centre des femmes (1972-1975) avec Nous aurons les enfants que nous voulons (1974, sur l’avortement), Moman travaille pas, a trop d’ouvrage ! (1976, sur le travail ménager) et As-tu vu ? Les maisons s’emportent ! (1981, sur la vie à l’intérieur des résidences). Lavoie compare brièvement la forme du Théâtre des cuisines au spectacle T’es pas tannée, Jeanne d’Arc?, du Grand Cirque Ordinaire (malgré une approche beaucoup plus poétique et moins sociale) par la présence de marionnettes et de chants d’inspiration brechtienne, en plus de mentionner Un Prince, mon jour viendra, sa création féminine présentée en 1974. Lorsque Carole Fréchette quitte le Théâtre des cuisines, le «désengagement politique» permet l’apparition de nouvelles voix de personnages et des univers oscillant entre le drame et l’épique. En 1989, Carole Fréchette revient à l’écriture dramatique après avoir notamment signé des critiques pour la revue Jeu. Pascal Riendeau traite de ses premiers pas en solo dans Baby blues et Les Quatre morts de Marie (où l’héroïne du même nom décède dans chacun des quatre tableaux). La dramaturge jongle toujours avec le féministe, mais sur des territoires plus intimes.

Jouée à Montréal dans une production professionnelle cinq ans après sa création, la pièce Les Sept jours de Simon Labrosse est analysée par notre collègue Sara Thibault. Cette œuvre, qui tend un miroir distant (et non frontal) sur le chômage et le monde du travail, ose également illustrer habilement une «déresponsabilisation» du public. L’altérité occupe une place de plus en importante avec Le Collier d’Hélène, scruté ici par Karine Cellard. La perte de l’objet précieux oblige le personnage à se décentrer d’elle-même et à apprivoiser les autres.
La confrontation entre la vérité et le mensonge constitue un enjeu majeur dans Jean et Béatrice. Marion Boudier expose avec tout autant de force les «illusions comiques» de l’amour où une femme vivant seule au 33e étage d’un édifice exige une succession d’épreuves à un homme prêt à l’aimer. S’ensuit la tout aussi intéressante étude de Barbara Métais-Chastanier sur Serial killer et autres courtes pièces. Dernière œuvre scénique de Carole Fréchette à avoir vécu sur une scène importante de la métropole, Je pense à Yu bénéficie de la brillante plume de Francis Ducharme. Traductrice, Madeleine voit sa vie remise en question à l’annonce de la remise en liberté d’un ancien étudiant emprisonné pour avoir lancé des œufs sur un portrait de Mao en 1989. Ducharme dévoile les questionnements subtils de l’auteure autour des traces du féminisme et du maoïsme des années 1970, entre rétrospection et introspection, entre l’histoire et l’Histoire.
Après les commentaires de Nicole Nolette sur Small Talk, de Denise Cliche sur Les Quatre morts de Marie et de Marie-Aude Hemmerlé sur La Peau d’Élisa, voici les deux brillantes contributions de Gilbert David et d’Hélène Beauchamp. Le premier se penche sur la vagabonde de Violette sur la terre, sorte d’alter ego de l’auteure qui se trouve dans une ville minière sur fond de crise, où, l’intime et le social s’enchevêtrent dans une rhapsodie résonnante. La seconde laisse suggérer l’écriture polyphonique de La Petite pièce en haut de l’escalier, une relecture contemporaine du mythe de Barbe-bleue où les voix intérieures sont confrontées aux perceptions des autres.

La partie suivante aborde le corpus fréchettien plus globalement avec Lucie Robert qui se penche sur le rôle de passeur devenu plus important pour les personnages avec les années. Hervé Guay focalise sur la place non négligeable des objets, alors que Louise H. Forsyth témoigne de l’éclatement de l’espace; la perte des repères personnels entraine la fin des apparences et une amorce de la liberté. Très présentes sur les scènes canadiennes-anglaises, les œuvres scéniques de Carole Fréchette suscitent diverses réactions, allant de l’émerveillement à l’incompréhension (certains critiques parlent même d’excentricité) comme l’explique Stéphanie Nutting.
Un appareil critique considérable complète le livre avec des photos de diverses mises en scène à travers le monde (seulement une du Québec!) et une bibliographie très détaillée.
«Croire qu’on peut défier les lois de la gravité, qu’on peut se tenir en équilibre entre action et introspection, entre l’appel du moi et celui du monde, et croire qu’il peut surgir du sens et de la beauté de cette simple traversée», espère de tout cœur Carole Fréchette. Une telle philosophie résume parfaitement le présent ouvrage, remarquable et essentiel.