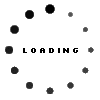Avignon, jour 5 – Ensevelie sous les papiers

Avignon, jour 5 – Ensevelie sous les papiers
En ce cinquième jour de présence au Festival, ma table de travail commence dangereusement à ressembler à une montagne de papiers. Entre les tracts, les billets, les programmes des théâtres, les dossiers de presse et mes notes, je pourrais probablement lancer ma propre petite fabrique d’éventails et faire fortune dans les rues d’Avignon, mais j’ai mieux à faire (et non, je ne suis toujours pas allée tester les glaces, place des Corps Saints).



Malgré la chaleur, mon cerveau parvient à garder le rythme, tandis que j’alterne les spectacles et la rédaction de critiques. J’ignore combien de temps je tiendrai et si d’autres journalistes sont dans ma situation. Un peu sauvage, je ne fréquente pas du tout les activités de socialisation, happy hours et autres conférences organisées par le Festival ou par le Off. Je devrais peut-être, mais le temps, toujours le temps qui manque!



Parmi les choses que je préfère faire, il y a me promener dans les rues et observer les files devant les théâtres. N’est-ce pas réjouissant de croiser autant de personnes passionnées ou curieuses aux portes des théâtres? Et des gens de tous les âges! Mais ça reste très blanc, je vous l’accorde. L’une des artistes que j’ai vue sur scène aujourd’hui, en provenance de Bruxelles, se désolait d’ailleurs de ne pas voir ses frères et soeurs des cités dans le public et sur les scènes avignonnaises. Avec l’arrivée de Tiago Rodrigues à la direction du Festival d’Avignon s’opère du moins déjà un vent de changement. « Je ne suis pas là pour imposer mes goûts, mais pour traduire, à l’aune de notre temps, les valeurs fondatrices d’exigence et d’accessibilité qui animaient le fondateur, Jean Vilar », confiait-il en entrevue dans Le Devoir.



La cuisine musicale – La pâte lève bien!
Avec son « concert lyrico-épicé » sans paroles, la compagnie française Minute Papillon offre une sympathique initiation à l’opéra aux tout-petits. Mise en bouche ludique, La cuisine musicale surprend et réjouit les petits comme les plus grands avec une jolie variété d’instruments… de cuisine.

Cette toute nouvelle création signée Violaine Fournier propose en effet un menu alléchant, composé d’oeuvres de Verdi, de Rossini, de Mozart et bien d’autres, qu’elle apprête à différentes sauces avec des articles et accessoires qu’on trouve en cuisine. Les deux chefs cuisiniers, très affairés à concocter un menu sophistiqué, réalisent rapidement que ce qui donne du goût à leurs recettes, ce sont les assaisonnements de notes, de percussions et de rythmes, sans compter le coeur qu’on met à les interpréter!
Jean-Luc Priano a fait preuve d’une grande ingéniosité et d’une belle imagination en créant les instruments du spectacle. Ils se dissimulent partout dans cette cuisine musicale : louche-flûte, ronds de poêle-xylophones, casserole-banjo, grille de four-harpe… et même tuyauterie-tuba! Tous les mouvements des interprètes forment des sons et des rythmes qui évoluent naturellement en chansons. Les interprètes Stéphane Zubanu Diarra, qui manie avec dextérité les instruments réinventés, et Violaine Fournier, dont les envolées lyriques charment les oreilles, créent de beaux échanges en laissant parler la musique.

Le répertoire lyrique y est revisité dans différents styles musicaux, du jazz au hip-hop en passant par la techno et les musiques du monde, ce qui donne lieu à des interprétations très amusantes. Cette approche accessible décloisonne l’opéra, qu’on a souvent tendance à croire sacré et « pas pour nous ». Dans cette cuisine musicale, au contraire, l’opéra surgit de partout.
Si le spectacle souffre d’un léger coup de mou avant d’arriver au dessert, avec un fil narratif ténu, il se termine par un grand festin de notes lorsque les cuisiniers réclament l’aide du public, soudain transformé en chorale. La préparation du repas se termine alors dans un bel ensemble et dans la joie communicative du Barbier de Séville.
Crédit photos : Cyrille Louge
Kheir Inch’Allah – Tableau familial par une hypersensible
Portée par le besoin de partager son histoire, Yousra Dhary a découvert sa sensibilité et sa fragilité sous la couche protectrice de la fille forte et indépendante qu’elle s’était bâtie en grandissant.
Dans Kheir Inch’Allah, Yousra se questionne sur son identité, elle, fille d’un père protecteur pas prêt à la voir grandir, soeur des drari (« frères » dans le langage de la rue et une identité que les jeunes revendiquent), fille masculine, femme divorcée, femme musulmane. Comment se définir au travers des regards que les autres portent sur elle dans la société patriarcale dans laquelle elle évolue?
Dans un décor dépouillé, mi-salon marocain mi-coin de rue, la jeune Yousra mitraille son verbe dans un étourdissant déversement de confessions : son père qui aurait voulu un garçon, sa mère qui n’a pas eu d’autres enfants, ses drari qui ne voyaient pas la fille en elle, ses tentatives de féminisation, les reproches constants sur sa façon de vivre sa vie. Tout cela, l’autrice nous les raconte avec beaucoup, beaucoup d’humour.

Native d’une commune de Belgique de parents marocains, Dhary signe un texte touchant, très personnel, qui trouve dans le vocabulaire et la musicalité du langage de ses drari une respiration et un rythme qui convoient une grande charge émotionnelle. L’autrice de slam et interprète donne ainsi vie à la jeune Yousra, enfant puis adolescente et jeune fille, jeune femme, mais aussi à sa mère dépassée, aux voisines compatissantes et écornifleuses, à ses amis, au vendeur dans la librairie confessionnelle; c’est toute une communauté que Dhary fait surgir à ses côtés dans ce premier solo, mis en scène par Mohamed Ouachen. Elle en brosse un portrait tendre, malgré les blessures subies, malgré les affronts et la misogynie.
Plein de tendresse et d’un bon sens de la dérision, Kheir Inch’Allah ouvre la porte sur une réalité différente pour mieux nous la faire connaître de l’intérieur. C’est chaleureux, sincère et surtout très drôle!
Crédit photo : Emilie Sfez
Le Beau Monde – Devoir de mémoire
Dans un futur lointain, un groupe d’artistes se rassemble dans la réplique « parfaite » d’un lieu du 21e siècle, dit « théâtre », pour perpétuer un rituel qui s’y répète tous les 60 ans : «reconvoquer» notre mémoire. Le Beau Monde se veut une reconstitution fidèle de rituels anciens (c’est-à-dire ceux de notre époque), du baiser aux larmes en passant par les vacances à la mer, la neige, les élections, le foot, les anniversaires ou même des concepts comme la nostalgie, la propriété, l’oubli ou le sens de la vie (un fragment perdu, hélas!).
Création collective excentrique signée Arthur Amard, Rémi Fortin, Simon Gauchet et Blanche Ripoche, Le Beau Monde est un brillant exercice de synthèse qui illustre la déconnexion entre signifiant et signifié. En effet, ces fragments de mémoire transmis de génération en génération par voie orale ont peu à peu perdu leur sens dans un monde d’où ces choses et rituels ont disparu. La valse devient un exercice mécanique, le baiser une succession d’étapes précises, la danse des canards se confond avec le Lac des cygnes, le paradis avec celui de la marelle…

La production recèle un riche humour absurde, car malgré toute leur bonne volonté, les trois artistes du futur n’ont pas la moindre idée de ce qu’ils reconstituent pour nous. Tout y est un peu de travers, entre trépieds placés tête en bas et vêtements enfilés à l’envers. Le décalage entre les fragments de mémoire présentés et ce que nous, public du passé, connaissons de ces petits riens du quotidien est chaque fois une délicieuse surprise. On prend plaisir à découvrir quel regard le futur pourrait porter sur nos drôles de pratiques, nos souvenirs, nos rêves, nos peurs, nos histoires. La fascination, la naïveté et l’ignorance avec lesquelles le trio les reconstitue font le sel de cet étrange objet scénique.
Futuriste, en toute simplicité, cette création de 2021 trouve dans la cour Montfaucon de la Collection Lambert un écrin tout désigné. Les grands murs de marbre blanc forment une boîte scénique qui laisse toute la place à notre imagination. Les voix s’y répercutent en écho, accentuant l’allure solennelle d’un rituel qui sacralise la banalité de nos quotidiens. Le Beau Monde pose aussi la question de ce dont on doit se souvenir, le beau comme le laid, de la façon dont on doit témoigner du passé (faut-il le faire fidèlement, le mettre en contexte, le censurer ?), et de l’importance de mémoire.

Alors que le monde change plus vite que jamais et que disparaissent chaque jour des connaissances, des traditions, des réalités, des témoignages de notre passé, sans que rien semble pouvoir freiner cette érosion, Le Beau Monde encapsule toute la richesse et la beauté, et oui, parfois, l’absurde des rites qui forment notre tissu social. Un exposé déconcertant et décalé qu’on explore avec le même plaisir que ses interprètes.
Crédit photos : Christophe Raynaud de Lage