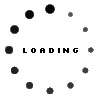Pomona, The Oresteia, Hamlet : une semaine à Londres
par Daphné Bathalon
Une fois qu’on a goûté au plaisir du théâtre en vacances à l’étranger, il n’est plus possible de s’arrêter! Après avoir eu un fantastique avant-goût de la scène londonienne avec Alice’s Adventures Underground cet été, j’ai eu la chance de retourner à Londres, pour une semaine (bien trop courte) à la fin de septembre. L’occasion idéale de poser le pied dans trois grandes institutions culturelles de la capitale britannique. Ne disposant que de quelques jours, je me suis limitée à ces théâtres, mais en me promettant bien de revenir pour d’autres explorations!
POMONA au National Theatre

Une fille est portée disparue depuis quelques jours. Sa soeur jumelle, Ollie, est prête à tout pour la retrouver. Tout? Elle va lentement s’enfoncer dans un secteur de la ville, sorte de trou noir au centre duquel se cache la pire des terreurs… La vérité elle-même pourrait-elle se dissimuler au fond de ce gouffre puant où la moralité est à géométrie variable?
Déjà présentée avec succès l’année dernière au Orange Tree Theatre, la pièce signée Alistair McDowell avait suscité un vif intérêt auprès du public et de la critique. Il faut dire qu’elle propose un univers contemporain et hyperconnecté à la fois sale, déroutant et fascinant.
Dans Pomona, tout est question de perception. Le titre de la pièce fait référence à une île déserte au coeur de la ville de Manchester où des projets de construction en béton n’ont jamais abouti. Les personnages qui vivent autour de cette île tantôt paraissent parfaitement lucides, tantôt semblent perdre la tête, si bien qu’à leur instar, les spectateurs ne discernent bientôt plus la réalité du cauchemar. Les séances de jeu de rôles, à la Donjon et Dragon auxquelles se livrent deux personnages, se confondent elles-mêmes avec la quête d’Ollie.

Dans le Temporary Theatre (annexe cubique rouge du National Theatre donnant sur la Tamise), la scène est encadrée par le public sur ses quatre faces et ne présente pour tout décor qu’une bouche d’égout octogonale, comme les dés que les personnages s’obstinent à lancer. De ces égouts remontent par moments remugle et sang. Pas de doute, on est près des caniveaux de l’humanité, des lieux hantés par la figure effrayante de Cthulhu, imaginée par l’auteur de science-fiction H.P. Lovecraft.
Décousue et décalée, Pomona nous entraîne dans un lieu dont on préférerait nier l’existence et nous amène à côtoyer des épaves en recherche de moralité. Lors d’une scène particulièrement marquante, un agresseur vient quêter une forme de pardon auprès d’une prostituée autrefois victime de violence conjugale. Une scène troublante qui nous maintient sur le bout de nos sièges. Avec les acteurs, on balance ainsi constamment à la frontière entre pulsion et raison.
Tensions, menaces et terreurs se côtoient avec délice dans cette brillante mise en scène de Ned Bennett, servie par une distribution en perte de contrôle… parfaitement contrôlée. Nadia Clifford joue à merveille la vulnérabilité et la détermination des soeurs jumelles, tandis que Sean Rigby, en garde de sécurité nerveux, se joue de notre compassion avec une belle habileté. Quant à Sarah Middleton, son look de jeune ingénue sert à merveille la figure vaguement menaçante qu’elle représente tout au long du spectacle.
Pomona propose un bel aperçu de ce que le théâtre d’horreur, voire le thriller théâtral, a à offrir. En espérant en voir davantage dans les saisons à venir au Québec!
THE ORESTEIA au Shakespeare’s Globe

Voir une production au Shakespeare’s Globe représente une expérience en soi qu’il vaut le coup de vivre. À 5 £ la place (debout au parterre ou jusqu’à 40£ pour les meilleures places, assises, dans les gradins), on aurait vraiment tort de se priver. Le théâtre, une reconstitution la plus fidèle possible du véritable et mythique Globe, est visité chaque année par des milliers de touristes. Ouvert sur le ciel londonien, et donc à la merci de la météo, il représente un détour incontournable pour l’amateur de théâtre classique, surtout qu’on n’y joue pas que du Shakespeare. Plutôt que de voir Richard II en mandarin, mon choix s’est porté sur The Oresteia, un grand classique d’Eschyle où le sang coule à flots.
L’Orestie raconte les malheurs de la lignée maudite des Atrides. À peine de retour de la guerre de Troie, le roi de Mycène, Agamemnon se fait assassiner par Égisthe, l’amant de sa femme, Clytemnestre (qui ne lui pardonne pas d’avoir sacrifié aux dieux leur fille aînée pour que les vents leur soient favorables). Face à ce terrible sacrilège, Électre et le jeune Oreste (exilé pour sa propre protection), les autres enfants du couple, ourdissent leur revanche pendant des années. Dès qu’il parvient à l’âge adulte, Oreste revient à Mycènes et tue sa mère et son amant. Un matricide que les anciens dieux veulent voir puni. Une trilogie théâtrale plutôt intense, donc, et régulièrement adaptée. Deux autres adaptations sont d’ailleurs présentées cet automne à Londres.

Celle de Rory Mullarkey reste sensiblement fidèle à la trame originale. La trilogie durant plus de six heures, cette adaptation, ramenée à trois, coupe malheureusement parfois les coins ronds. Le personnage d’Électre est celui qui en souffre le plus. Ce personnage féminin fort et complexe est pourtant l’une des figures les plus intéressantes de L’Orestie. La production du Globe s’attarde davantage à la reine Clytemnestre, à sa fureur maternelle et à sa sanglante destinée, lui mettant même dans la main l’arme qui a tué son mari (alors qu’Égisthe est le meurtrier dans l’œuvre originale), puis au jeune Oreste, pauvre instrument des dieux. Mullarkey propose une adaptation néanmoins dynamique, résolument moderne et accessible à tous les publics.

Magistrale en Clytemnestre, Kathy Stephens offre une performance à la hauteur du personnage. Fière, intraitable, dure et maternelle tout à la fois, sa Clytemnestre parvient à émouvoir autant qu’à faire trembler. Sa présence sur scène magnétise les regards, au point de faire de l’ombre à Électre et même à Agamemnon, pourtant royal et victorieux à son entrée dans la ville. Vêtue d’une robe noir et blanc qui finit entièrement teintée de sang, Stephens livre une interprétation à donner des cauchemars. Il manque un peu d’énergie combative au départ à l’Oreste, incarné par Joel MacCormack, mais le jeune acteur finit également par nous convaincre grâce à son impétuosité. En Égisthe, Trevor Fox s’en donne visiblement à cœur joie : son discours aux accents victorieux mais avinés fait largement sourire.
Si la décision de la metteure en scène Adele Thomas de moderniser l’époque de l’histoire (les costumes, surtout ceux du chœur, rappellent plutôt le 19e siècle) apporte bien peu au contexte de L’Orestie, sa mise en scène inventive propose plusieurs tableaux visuellement réussis et qui tirent le meilleur parti de l’architecture des lieux. Par ailleurs, la metteure en scène assume complètement son côté gore en déversant quantité de sang sur scène et en n’hésitant pas à administrer quelques électrochocs au public, surtout en première et en deuxième partie.
Par comparaison, la troisième partie, portant sur le procès d’Oreste, semble plus molle et même longuette, elle qui est pourtant la plus courte des trois. Drôle de choix aussi pour la finale que cette parade grotesque à la gloire de la phallocratie. Le jugement des dieux, donnant préséance au droit de vengeance d’Oreste de punir le meurtre de son père par le meurtre de sa mère (parce que la femme n’est que le réceptacle de la semence de l’homme), soulignait déjà assez bien cette conclusion. Une danse clôt traditionnellement les productions du Globe, mais on aurait aimé un peu plus de subtilité, ce dont l’ensemble de la production manque en général.
Malgré quelques faiblesses, The Oresteia célèbre avec plaisir et adresse la grandiloquence de la tragédie grecque.
HAMLET au Barbican

Un an même avant sa première levée de rideau, l’adaptation d’Hamlet proposée par Sonia Friedman Productions marquait l’histoire du théâtre britannique en devenant la production ayant vendu ses billets le plus rapidement, soit en l’espace de quelques heures. Le nom de l’acteur britannique Benedict Cumberbatch (connu pour son rôle de Sherlock dans la série de la BBC) n’étant certainement pas étranger à l’affaire. Véritable phénomène international, l’acteur fait en effet courir les foules, et de partout dans le monde. Besoin d’une autre bonne raison pour, poussé par la curiosité, se rendre au Barbican lors d’un voyage à Londres? Cumberbatch est bon. Voire même excellent.
Sans doute l’une des pièces de Shakespeare les plus montées dans le monde, Hamlet ne perd pas de son attrait malgré les siècles écoulés depuis sa création, surtout auprès des acteurs, pour qui le rôle-titre représente un véritable défi dans une carrière. Plusieurs grands acteurs se sont frottés au prince du Danemark, certains ont laissé leurs marques de manière durable. Pensons aux interprétations saluées par la critique de Kenneth Branagh ou, plus récemment, de David Tennant. Cumberbatch s’inscrira-t-il dans leur lignée? Peut-être pas, mais son Hamlet intense, à la fois brillant de douleur et de folie, n’a pas à rougir de la comparaison. L’acteur, qui maîtrise parfaitement son texte, glisse avec naturel de la froide lucidité aux instants de folie, à la rage ou à la franche camaraderie. Ses échanges avec Horatio (Leo Bill, qu’on voit trop peu) sont d’ailleurs une bouffée d’air frais dans un tourbillon de noirceur. Aux côtés de Cumberbatch, Jim Norton en Polonius est certainement celui qui tire le plus son épingle du jeu. Son vieil homme, père et conseiller niais, fait rire aux éclats plus d’une fois, et ses échanges avec tantôt le roi et la reine, tantôt avec Hamlet lui-même, sont du plus haut comique malgré les nombreuses coupes dans ses répliques. Dans le registre tragique, les trop discrètes Gertrude (Anastasia Hille) et Ophélie (Siân Brooke) ont heureusement l’occasion de briller dans une scène solide et émouvante où la reine tente d’apaiser la folie de la jeune fille. Dommage que la scène finale, où le sort de tous est scellé, semble aussi précipitée. Les personnages y tombent comme des mouches sans que le public ait la possibilité de suivre les réactions de chacun.

L’impressionnante scénographie d’Es Devlin, mise en lumière avec doigté et intelligence par Jane Cox, structure elle-même la production en lui permettant de jouer sur plus d’un niveau. Figurant le palais d’Elseneur, l’intérieur luxueux renchérit à grand renfort de fer forgé, de tableaux, de lustres et de murs ouvragés dans un design fermé sur lui-même qui accentue l’impression de confinement. Tantôt au balcon, tantôt au milieu du grand escalier ou en fond de scène dans une antichambre lumineuse ou inquiétante, les acteurs occupent l’espace dans un ballet efficace et précis, soutenus par une petite armée de figurants (valets, rebelles, soldats ou conseillers). Dans ce palais plutôt baroque, les multiples portes sont autant de sources de lumière ou d’ombre, mais jamais d’ouvertures vers l’extérieur. Au contraire, toutes les portes paraissent ramener les personnages vers cette grande salle de banquet dont ils ne sortiront pas vivants. En deuxième partie, la pourriture qui règne au royaume du Danemark et qu’on entrapercevait à peine par quelques jeux d’éclairage aux premiers actes envahit définitivement le palais. Les personnages trônent alors sur des monceaux de déchets et de cendres qui ont recouvert les moindres recoins du palais. Une transformation radicale de l’espace plutôt impressionnante.
Reste que passé la brillance de la distribution et de la scénographie, cette production signée Lyndsey Turner demeure plutôt sage et traditionnelle. Remonter Hamlet aujourd’hui devrait signifier qu’on a quelque chose de nouveau à dire à travers le drame vécu par le jeune prince, quelque chose sur l’isolement, la peur, la suspicion, la filiation, le devoir, la loyauté… Or, la production du Barbican, malgré ses belles idées, n’apporte rien de nouveau ou de surprenant. Rien qui ne dépasse ou ne prenne le public à rebrousse-poil. Si bien que sans la présence de la star Cumberbatch, on peut se demander ce que l’histoire retiendra au final de cette nouvelle mise en scène.
Hamlet sera présenté par le National Theatre Live à Montréal (Cineplex Forum, Brossard et Cavendish) le 15 octobre prochain. Les projections affichent pour la plupart complet, aussi la production sera-t-elle projetée à nouveau en novembre. Cliquez ici pour pour d’infos et surtout, pour réserver vos places!