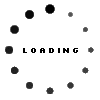Avignon partie 3 : dans les rues

Par Daphné Bathalon
Chapitre 3 : L’exploration
Dans les rues d’Avignon, outre les personnes qui tractent (très nombreuses, on en croise tous les dix pas), il y a aussi les badauds, qui cherchent une terrasse, un théâtre, leur chemin, et puis les gens qui courent, l’air déterminé, sortant sûrement d’une salle pour aller s’installer dans une autre. À vouloir tout voir, on se bâtit parfois un horaire un peu trop juste : les rues d’Avignon allant dans toutes les directions sauf la ligne droite, il faut calculer le double du temps que laisse croire la curieuse échelle du plan de la ville. Pour ma part, quand j’ai le temps de flâner, je trouve très agréable de détailler les affiches accrochées un peu partout, même là où ce n’est pas permis. Il y en a de magnifiques, d’artistiques, de mystérieuses ou de criardes, voire de ringardes. Il y en a que j’accrocherais volontiers dans mon bureau, pour décorer, et des tracts que j’accepterais de prendre, seulement pour le plaisir des yeux. Les compagnies le savent, l’affiche compte pour beaucoup dans le choix des spectateurs.

Et puis, il y a aussi le plaisir de s’asseoir à une terrasse et de regarder le manège du tractage perpétuel. Un bon tractage peut faire la différence entre une salle vide et une salle comble, et les compagnies passent de nombreuses heures chaque jour, entre les représentations, pour le faire.
Dans les rues, le Festival d’Avignon, l’officiel, se fait discret. Quelques bannières aux entrées des salles, de l’affichage, près du quartier général, au cloître Saint-Louis. Le Festival n’a pas besoin du tapage perpétuel de son Off. Même son public, plus tranquille, se distingue dans la foule.
Alors que la température fléchit enfin, la fièvre des spectateurs continue de brûler. Tant mieux! Au programme off du jour pour moi, trois expériences très différentes…
JE (SE TERRE) (La Bao Acou)

Il est de ces épisodes peu glorieux dans l’histoire d’une nation… En fait partie les bagnes pour enfants qui ont existé en France jusque dans les années 1960. Y étaient envoyés, sans discernement, les enfants coupables d’un crime (même le vol de nourriture) et les enfants placés par leur père comme forme de punition ou pour être « redressés ». Ils y étaient souvent battus, humiliés, violentés. Y mourraient aussi, parfois. L’une de ces colonies pénitentiaires, à Belle-Île-en-mer, fut rendue tristement célèbre par la chasse à l’homme organisée à la suite d’une évasion massive en 1934, et que Jacques Prévert dénonça dans un poème qui souleva l’opinion public.
Cette histoire inspira deux films, mais aussi la compagnie La Bao Acou, qui propose avec JE (se terre) de suivre JE, seul des évadés à ne pas avoir été retrouvé. JE se cache dans le noir, avec ses souvenirs, ses terreurs, dans sa tête, dans sa chair, il n’est plus qu’un déversement de mots et de pensées, qui sortent en rafale de sa bouche.
Plongés dans le noir avec lui, les spectateurs n’ont d’abord rien à quoi se raccrocher. Face au mur, comme des enfants en pénitence, ils ne voient ni n’entendent rien. Puis, il y a une courte narration, qui brise le silence et laisse le spectateur dérouté, sur sa faim. C’est quand JE se fait enfin entendre que le texte de Benoît Schwartz trouve un souffle. La voix de l’auteur et comédien nous berce de phrases hachurées, comme échappées de la bouche de JE, qui observe, énumère, décrit, avec un détachement terrible, celui de l’enfant qui n’a plus de repère, que le noir et la peur. « Ne pas mourir, ne penser qu’à ça. »
En orientant chaque spectateur (pas plus d’une quinzaine) face au mur, Schwartz renforce efficacement l’effet d’étrangeté et d’isolement, celui ressenti par le personnage. Un isolement qui lasse toutefois après un moment, car il n’évolue vers rien de particulier. On sent parfois dans la voix de JE l’impuissance de l’enfant, sa terreur d’être traqué comme une bête, mais le spectateur, bercé par cette voix qui surgit de l’obscurité finit par décrocher. Aurait-il fallu jouer de clairs-obscurs? Se déplacer plus près des spectateurs, dans leur bulle, insuffler des changements de rythme dans le tourbillonnant soliloque de JE? Malgré la beauté du texte et ses images fortes, la répétition et la noirceur créent rapidement une certaine torpeur.
Le concept du spectacle (saluons l’audace!), le texte et la musique (réalisée en direct par le guitariste et compositeur Stéphane Kerihuel), qui déchire par moments le lourd silence, font tout de même de JE (se terre) une expérience singulière.
HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER (La Petite Compagnie et Courants d’Art Production)

Ce n’est pas tous les jours qu’on croise la route d’un chat qui parle, encore moins d’un chat comme Zorba, qui paresse dans le port d’Hambourg par une belle journée, mais dont la sieste sera troublée par la chute d’une mouette goudronnée à laquelle il fera trois promesses…
L’histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler, adaptée du texte du même titre par l’écrivain chilien Luis Sepùlveda, c’est celle de Zorba, donc, qui va couver l’oeuf pondu par la mouette agonisante puis élever le poussin qui en sortira, Afortunada, jusqu’à ce qu’il vole de ses propres ailes. Le roman, publié il y a 20 ans, raconte l’amour et l’amitié improbables qui se développe entre deux êtres que tout sépare : l’un a des plumes, l’autre des poils, l’un aime l’eau, l’autre la fuit, l’un sait voler, l’autre reste obstinément au sol.

Seul en scène, le comédien Patrick Courtois incarne tous les personnages. Délaissant rapidement le rôle du narrateur et sa redingote, il se glisse dans la peau de Zorba le chat avec une grâce toute féline. Sans maquillage ni costume, il parvient à devenir chat. Il en a l’orgueil, la paresse, la gourmandise et la ruse. Il n’a pas davantage de mal à faire vivre toute la tribu de chats vivant sur les quais, depuis le patriarche Colonello aux allures de mafioso au petit malin Jesaistout, qui croit tout savoir, au roi des rats, mais c’est son interprétation de l’attachant Secrétario qui conquit le jeune public et les parents présents.
Afortunada, elle, est représentée par un simple ballon blanc pourvu d’un bec et de petites pattes. Au milieu des caisses de bois, des filets de pêche et des bouées, il n’en faut pas plus pour nous faire croire à cette jeune mouette qui se prend pour un chat et pour nous faire sentir le vent du large.
De la production mise en scène par Carl Hallak se dégage beaucoup de tendresse, tant pour les personnages que pour les enfants dans la salle. L’histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler est une belle et douce fable sur la richesse de la différence, une leçon servie avec humour et intelligence.
VISAGE DE FEU (Les Voyageurs)

Toujours au Off, la compagnie Les Voyageurs faisait un passage trop bref à Avignon avec son excellente production Visage de feu, de l’auteur allemand Marius Von Mayenburg.
Kurt et Olga, frère et soeur, n’en peuvent plus de la présence de leurs parents. L’un trouve refuge dans une adolescence qu’il refuse de quitter et une certaine libération dans sa pyromanie, l’autre cherche à devenir une femme pour échapper à une enfance qui l’étouffe. Les personnages de Visage de feu ont quelque chose de profondément ducharmien. Comme Bérénice et Christian, de L’avalée des avalés, Kurt et Olga brûlent d’un amour incestueux et méprisent leurs parents, dont ils refusent le modèle. Le noyau familial est en crise perpétuelle, et si la guerre n’est pas encore déclarée, elle couve dangereusement. On retrouve dans la révolte de Kurt et Olga des traits des personnages de Réjean Ducharme : cette volonté féroce de ne pas se reconnaître dans les parents, ce refus intraitable de tout consensus, ce besoin d’être entier, maintenant. Ils se veulent libres, indépendants, mais ne voient autour d’eux qu’un champ de batailles à mener, aucune échappatoire. Ils sont coincés, comme leurs parents, dans un quotidien étouffant, fait de repas de famille où plus personne ne se dit rien.

Il y a dans ce texte de Von Mayenburg le dépassement de parents « déjà morts » et la rage improductive d’une jeunesse en manque de repères. Cette jeunesse, le metteur en scène la place dans le décor triste et froid d’une maison sans âme et déjà à moitié dévorée par les flammes qui la consument de l’intérieur. La source? Kurt, immobile à son extrémité de la table. Autour de lui, que charbon et bois carbonisé. Il n’en bouge et s’anime que lorsque vient enfin son heure. C’est quand tout part en fumée que Kurt, enfin, se libère de son immobilisme. Le metteur en scène Pierre Foviau joue habilement avec le feu en proposant d’abord une lente mise en situation dont l’arrivée de Paul, nouveau petit ami d’Olga, viendra bouleverser le fragile équilibre. Son arrivée servira de détonateur.
Dans le rôle des parents, Marie Boitel et Thierry Mettetal sont absolument parfaits, couple par habitude plus que par amour, deux solitudes vivant côte à côte et n’exprimant que désarroi et incompréhension devant les agissements de leurs enfants perturbés. Ils prêtent à rire, bien sûr, mais leur incapacité à stopper l’autodestruction de leur famille en fait aussi des personnages tragiques, et les deux acteurs les incarnent avec beaucoup d’affection et de naturel. Émile Falk-Blin et Marion Lambert héritent de partitions difficiles tant leurs dialogues semblent déconnectés. Kurt en particulier s’exprime la plupart du temps sans émotion, comme détaché de lui-même, toujours campé dans le refus; difficile dans ce cas pour le public de se lier au monstre qui, lentement, se dévoile sous ses yeux. Olga, elle, brûle encore de s’émanciper, de vivre libérée des entraves de sa jeunesse, mais rage de ne pas savoir comment s’y prendre. L’énergie de Lambert est irrésistible. Le Paul d’Adrien Desbons est le chien dans le jeu de quilles, l’amoureux par entêtement, le beau-fils par procuration. Bref, l’élément de normalité auquel le public se raccroche.
La production des Voyageurs possède le souffle de l’explosion, et si l’incendie est lent à venir, son flamboiement final n’en est que plus impressionnant.