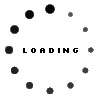Avignon partie 4 : hors les murs

Par Daphné Bathalon
Chapitre 4 : la parole
Tous les matins, Avignon semble se réveiller avec une terrible gueule de bois, un effet renforcé par les centaines de tracts et d’affiches jonchant le sol, comme au lendemain d’une très grande fête. C’est d’autant plus vrai ces jours-ci, alors que la canicule a cédé le pas au mistral, un vent frais qui a fait chuter le mercure de 15 bons degrés… et de très nombreuses affiches, qui gisent à présent déchirées un peu partout. Dès 11h pourtant, Avignon regagne en vigueur, ses terrasses se remplissent et les rues recommencent à résonner de mille et une conversations, des coups de clairon de cyclistes pressés et des harangues habituelles.
Cette année marque le 70e anniversaire du Festival d’Avignon et le 50e de son Off, des âges vénérables qui apportent de saines remises en question. Les artistes, critiques et professionnels du théâtre sont plus nombreux qu’on croit à vouloir s’éloigner d’Avignon. Chaque année, il est vrai, apporte son lot de contestations et de critiques ouvertes ou à mots couverts sur la programmation de son directeur artistique, Olivier Py. Déjà en 2001, l’homme de théâtre Claude Régy appelait à la disparition, du moins momentanée, du festival : « Pensez à ce que l’on voit dans les rues d’Avignon pendant les tristes semaines où se manifeste cette monstruosité qu’est le Festival et qui ressemble plus à une foire-exposition qu’à quelque chose qui aurait encore quelque lien avec l’art. D’ailleurs, il faudrait supprimer le Festival d’Avignon pendant plusieurs années, qu’on oublie cette infection pour avoir idée de reconstruire autre chose. » («Il faudrait supprimer Avignon», Libération, 5 juillet 2001)
Quelques jours avant le défilé qui marque le lancement officiel du Off, Avignon Festival et Cies, l’organisation qui chapeaute ce grand événement en parallèle du IN, publiait un dossier de presse invitant à son évolution sur le plan de sa gouvernance, mais aussi quant à son rôle auprès des professionnels des arts vivants. Le Off devrait notamment offrir un meilleur encadrement et un plus grand soutien aux compagnies et productions inscrites au programme (notamment par la distinction entre compagnies professionnelles et amateurs), et accorder plus d’importance au développement de ses publics, en plus de présenter une plus grande ouverture sur la pratique des arts vivants dans le monde (il est vrai que sur plus de 1000 spectacles, moins de 200 proviennent d’ailleurs et une fraction seulement est présentée dans une autre langue que le français). Enfin, le Off souhaite encourager une pratique plus écologique (l’affichage et la distribution de tracts sont un gâchis écologique et économique sans nom).
Dans les salles, le public demeure malgré tout au rendez-vous, année après année. Aux portes des salles du IN, des spectateurs pleins d’espoir brandissent des pancartes indiquant le nombre de billets recherchés, aux portes des salles du OFF, les files s’allongent trente minutes avant le début des représentations, ainsi que les listes d’attente…
MACBETH EXPÉRIENCE (Collectif Mains d’oeuvre)

Drôle de spectacle que cette production du Collectif Mains d’oeuvre. Misant sur un visuel sombre et sérieux, Macbeth expérience peut laisser croire à une réinterprétation esthétique de celle qu’on appelle la pièce maudite de Shakespeare et que les Anglo-saxons montent bien moins volontiers que les Hamlet, Othello ou Richard III. Or, le collectif propose plutôt une adaptation, certes fidèle dans les grandes lignes, mais assez limitée en intérêt.
Pourtant, la mise en abyme du début prête à sourire : les trois comédiens, nerveux, attendent que les spectateurs prennent place, finissent d’installer leur décor, se répartissent les rôles. Chaque personnage est diligemment présenté, avec tous les clichés associés aux personnages shakespeariens. La mise en bouche est amusante, et la sympathie du public pour la petite troupe est immédiatement acquise. Passé l’introduction, le spectacle demeure malheureusement dans le même ton. Les scènes sont expédiées trop rapidement pour qu’on puisse y retrouver les subtilités politiques et les déchirements moraux des personnages, et ceux-ci, dont la pauvre Lady Macbeth, se retrouvent souvent réduits au premier niveau de lecture. Le procédé fait rire, mais il frustre également, surtout pour un texte aussi riche et complexe. On cherche en vain le « jeu subtil de mise en abyme » et la mise en lumière des « puissants enjeux de l’oeuvre ».
Macbeth expérience est néanmoins servi par un excellent sens du comique, la polyvalence de ses acteurs et un magnifique travail de lumière et de vidéo. À ce titre, les projections et les séquences vidéo à elles seules valent bien le détour, en particulier les tableaux mettant en scène les trois sorcières (il faut voir Caroline Fay les incarner tour à tour grâce à de simples changements d’éclairage).
Alléchée par les photos de production et la proposition de départ, je suis finalement ressortie plus déçue qu’allumée par cette expérience.
ALORS QUE J’ATTENDAIS (de Mohammad Al Attar)

Les occasions de voir des productions venues du Moyen-Orient étant plutôt rares, il ne fallait pas rater au IN cette année le passage d’Alors que j’attendais, de l’auteur syrien Mohammad Al Attar et mis en scène par Omar Abusaada.
Un hôpital à Damas, une mère en désarroi, un fils, Taim, plongé dans le coma après avoir été violemment battu à un des nombreux checkpoints fractionnant la ville. Le fils est là, il entend tout, voit tout, mais n’est plus que le témoin des confrontations déchirantes de sa famille. Sa mère, qui s’est réfugiée dans la religion après la mort du père, sa soeur, Nada, partie à Beyrouth deux ans plus tôt pour fuir la capitale syrienne assiégée, le poids de la religion, et par besoin de se retrouver, Salma, sa copine, qui n’est pas certaine des raisons qui l’ont poussée à rester auprès de lui et songe aussi à s’exiler.
La scène sur deux plateaux sépare les vivants de ceux dont l’âme vagabonde. Dans un angle, un poste d’enregistrement où Taim témoigne de la révolte de sa génération, des jeunes descendus dans la rue pour s’opposer au président et à ceux qui détiennent le pouvoir. Le public y voit des images, bien réelles, des manifestations qui ont ébranlé les rues, quand le peuple avait encore l’espoir de changer les choses. Mais comme Taim, la Syrie est à présent dans une sorte de coma, ni vivante, ni morte, stagnant dans un perpétuel état de crise, dans une zone grise dont on ne sait plus si on peut espérer la voir sortir ou se désespérer de la voir s’y enfoncer. Aux côtés de Taim, il y a aussi Omar, dans le coma, qui avait choisi, lui, de se tourner vers Daech pour trouver une solution aux injustices commises contre son pays et son peuple.
Le texte d’Al Attar reflète la quête de sens et d’identité d’une jeunesse qui vit dans un pays en ruines ou qui essaie de le fuir, en tournant souvent le dos à la famille, aux amis, aux proches. Alors que j’attendais parle de révolte, de résilience, mais surtout de colère et d’espoir. Le spectacle ne propose aucune analyse, aucune explication, aucune solution à la crise, il parle de politique, mais par le prisme du noeud familial. C’est la parole d’une jeunesse perdue qu’il est important d’entendre, car bien peu présentée dans nos médias occidentaux, surtout férus d’images de violence.