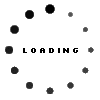Avignon : Jour 5 – Encore, encore!

DAPHNÉ À AVIGNON – PARTIE 5
Suivez notre collègue Daphné Bathalon dans son périple à Avignon, centre névralgique du théâtre en Europe durant la saison estivale !
Mercredi 18 juillet 2018
Au cinquième jour, une certaine routine s’est établie. Réveil à 8h30 au son du téléphone qui entame Les hélicoptères, de Louis-Jean Cormier, petite douche froide pour partir du bon pied, un peu d’écriture, vaisselle et puis départ pour le premier spectacle de la journée. C’est encore tranquille à 10h dans les rues, je croise des flâneurs, des gourmands en terrasse, café, croissant et journal à la main, des curieux lisant les coupures de journaux affichées aux entrées des théâtres, quelques artistes distribuant leurs tracts.
À La Manufacture aussi, c’est bien calme, la billetterie n’est pas encore ouverte, 30 minutes avant la représentation de Under Ice. Je suis peut-être un peu tôt finalement… C’est parfait, ça me donne le temps de continuer à rédiger ce blogue, à prendre le pouls d’Avignon, au son du piaillement des hirondelles. Hier soir, c’est le ballet des chauves-souris dans la cour du lycée face à mon appartement qui me fascinait. Elles sont sans doute parmi les rares à continuer à s’agiter après le départ du public, des artistes, des gens du milieu, des touristes, à la fin de l’été. On dit qu’Avignon est une ville impersonnelle et un peu morte hors période des vacances. Si tous les commerces font en un mois ou deux leur chiffre d’affaires de l’année, ça n’a rien d’étonnant. Combien de locaux vides pendant le reste de l’année?
Avignon le OFF est l’une vitrine unique pour les producteurs en manque de diffuseurs et les artistes en manque de visibilité. Avec les années et la baisse généralisée du financement de la culture, Avignon est aussi devenue un gigantesque entonnoir, un goulot d’étranglement pour les compagnies, car l’un des derniers lieux où on peut espérer, peut-être, signer un contrat. Il faut le dire, les compagnies ne viennent pas au OFF pour les beaux yeux du public, la plupart dépensent une fortune pour se loger, louer une salle, créer des affiches et autres publicités par espoir de se faire remarquer. Une compagnie peut payer jusqu’à 25 000 euros pour une salle, une dépense que le prix d’entrée déboursé par les spectateurs ne remboursera qu’en partie. Et, en fin de compte, très peu de ces compagnies décrocheront des contrats de diffusion. Il faut voir la flamme s’emparer des acteurs lorsqu’ils savent des programmateurs présents dans la salle! Pour ces heureux élus, c’est l’occasion de rentabiliser le séjour. Mais pour une poignée de théâtres qui prennent soin de construire une programmation diversifiée et de qualité comme La Manufacture, les Doms ou les Halles, combien d’autres louent uniquement par appât du gain en tirant le maximum de profit des compagnies qu’ils accueillent? Certains théâtres ressemblent davantage à des usines à saucisses qu’à des lieux de création.
Et pourtant, les artistes (et le public) reviennent d’année en année. Parce que sous ses allures de foire commerciale, Avignon demeure une folle aventure artistique, un bouillonnement de rencontres et de découvertes. Pendant ce rendez-vous, amateurs de théâtre, curieux, créateurs et professionnels du milieu discutent de mille et un sujets. Il y a le bonheur de découvrir, dans l’immense buffet all-you-can-eat, les spectacles qui en valent la peine, qui nous transportent ailleurs ou nous proposent quelque chose de différent.
La proposition de la compagnie lituanienne Arturas Areima Theater que je m’apprête à voir en ce matin du cinquième jour fait partie de ceux-là.
UNDER ICE
Coproduction Artūras Areima Theater et Oskaras Korsunovas Teatras

Metteur en scène lituanien bien connu de la scène underground, Artūras Areima offre une vision singulière et perturbante de la vie en entreprise avec la production Under Ice, de l’auteur allemand Falk Richter.
« À l’autre bout était le ciel qui se précipitait contre l’horizon. Moi, j’étais ici, avec ma tête beaucoup trop lourde… » Dans une mer de bouteilles d’eau aussi vite consommables et jetables que les employés d’une compagnie obnubilée par la performance, le personnage brillamment incarné par Rokas Petrauskas est muselé par sa personnalité effacée. Le corps prostré dans un fauteuil de cuir noir, encerclé de toutes parts par des micros, pointés dans sa direction comme autant de mitraillettes, il s’exprime sur un ton si éteint et bas qu’il faut un moment pour réaliser que c’est lui qui parle. Face à lui, les visages de deux hommes d’affaires (Dovydas Stončius, Tomas Rinkūnas) eux aussi en complet-veston-cravate disparaissent complètement derrière les visières de casque de moto, façon Daft Punk.
La mise en scène chargée de symboliques laisse place à de nombreuses interprétations et se refuse à situer le lieu, l’époque, l’histoire. Il y a seulement cet homme, Paul Personne, pris au piège sous une glace d’exigences sociales et de performances et qui veut désespérément que quelqu’un l’entende. Derrière lui défile une succession d’images tirées des grands médias, d’archives ou de l’actualité, sans lien logique apparent.
Le propos de Richter devient explosif dans cette production, créée en 2015. C’est une charge à fond de train contre l’aliénation par le travail et contre un monde où les hommes eux-mêmes ne sont plus qu’accessoires, un monde qui pourrait très bien vivre sans nous. Le texte recèle une grande poésie et une férocité mise en valeur par la scénographie décalée. L’interprétation d’abord détachée, puis de plus en plus brûlante, jusqu’à se rapprocher de la folie au fur et à mesure que l’espace scénique se sature d’images et de sons.
Under Ice met en pièces la rhétorique libérale en soulignant la violence humaine d’une société guidée uniquement par la rentabilité. L’apaisement final n’arrive qu’à la disparition de l’homme, sur une planète qui continue tranquillement de tourner.
VINCENT
Compagnie Cicada Productions

Sous le regard perçant de Vincent Van Gogh, son frère Théo se présente à nous, triste et honteux de n’avoir pu parler de son frère lors de son enterrement. Face à ses amis réunis, l’occasion est idéale de se rattraper et de nous dépeindre Vincent tel qu’il a été de son vivant.
En 1981, Leonard Nimoy (oui, M. Spock en personne) transformait sa passion pour le peintre en une pièce de théâtre basée sur les nombreuses correspondances entre Vincent et Théo. C’est par ces lettres (plus de 1670 pages) que l’auteur nous fait accéder aux pensées et réflexions les plus intimes de l’artiste. Il les transforme en un témoignage chargé d’émotion alors que Théo parle de leur relation fraternelle au gré des frasques et des troubles physiques et mentaux de Vincent. Le spectacle, qui tourne en anglais depuis 2012, connaît un joli succès depuis sa création en français en 2015. La production résonne avec beaucoup de naturel grâce à une mise en scène sobre de Paul Stein.
Sur scène, l’espace se construit autour de quelques meubles de bois, une table, des chaises, un chevalet, évoquant les différents lieux habités par l’artiste, de La Haye à Arles en passant par Paris et Saint-Rémy-de-Provence. Formidable, Jean-Michel Richaud se glisse sans effort dans la peau de l’émotif Théo et de son frère Vincent, toujours emporté dans l’exultation ou les affres de la passion. Le comédien leur donne à tous deux une grande vulnérabilité et parvient à insuffler à son Théo toute l’admiration et le respect qu’il avait pour son frère en tant qu’être humain, mais aussi en tant qu’artiste. La présence forte et fragile du comédien fait vibrer le texte et les œuvres qui défilent à quelques moments sous nos yeux.
La pièce de Nimoy explore en profondeur la nature de ce grand artiste, tout en s’interrogeant sur le regard que la société pose sur la maladie mentale. L’interprétation profondément émouvante que livre Richaud donne vie à l’homme derrière le peintre tandis que les œuvres projetées donnent à admirer les paysages, les lieux, les lumières et les couleurs évoqués par Vincent dans ses échanges épistolaires. Un voyage instructif et inspirant.
DE DINGEN DIE VOORBIJGAAN (Les choses qui passent)
Compagnie Toneelgroep Amsterdam, Toneelhuis
Coproduction Ruhrtriennale

Après avoir exploré la damnation d’une famille allemande ayant fait fortune dans l’acier sur fond de montée du nazisme dans Les damnés en 2016 dans la Cour d’honneur, le célèbre metteur en scène belge Ivo van Hove revient à Avignon pour présenter son adaptation du roman Les choses qui passent, de Louis Couperus, auteur fort peu connu hors des Pays-Bas, d’où il est originaire.
Le roman publié en 1906 raconte les malheurs d’une famille hollandaise en pleine décomposition, alors que la matriarche, Ottilie, attend la mort, non sans tourments. Autour d’elle gravitent trois générations, toutes hantées par un crime terrible commis 60 ans plus tôt par Ottilie et son amant, Takma. Certains savent de quoi il retourne, d’autres sentent simplement cet horrible secret peser sur leur vie, en écraser tout soupçon de bonheur ou d’amour.
Sur le grand plateau dépouillé (habituel chez van Hove), 15 comédiens et comédiennes vêtus de noir, comme autant d’âmes endeuillées, traînent une kyrielle de désirs frustrés, prisonniers de vies qu’ils n’ont pas souhaitées, d’espoirs déçus et de non-dits. Au fond, un grand miroir prolonge la scène, multiplie les 32 chaises alignées de part et d’autre de l’espace de jeu, et renvoie au public sa propre image. Au centre de cette antichambre de la mort aux allures de salle d’attente glaciale, Ottilie et Takma attendent qu’enfin vienne le châtiment pour leur crime. Leurs silhouettes recroquevillées font bloc. Dans le rôle de la grand-mère, Frieda Pittoors est magistrale de sobriété, portant avec ses petits yeux brillants et sa voix frêle tout le poids des fantômes qui la hantent.
L’ensemble de la distribution joue d’ailleurs en virtuose de la partition qui lui est offerte dans une interprétation marquée de longs silences et rythmée par les accents de la langue néerlandaise. Ils incarnent l’image même de la mélancolie et de la hantise du temps qui passe, tout en étant englués dans un marasme lourd. Le temps, égrené inéluctablement par toutes sortes de tic tac en musique de fond, ne semblera les libérer que lorsque la mort surgira et fera éclater le noyau familial.
Avec Les choses qui passent, le passionné de politique et de relations de pouvoir Ivo van Hove s’offre une plongée impressionnante dans des relations familiales empoisonnées par le silence. Si l’histoire de ces enfants maudits pour un crime commis par leurs aïeux n’a rien de très nouveau sur nos scènes, la mise en scène précise de Van Hove la métamorphose en un requiem saisissant.