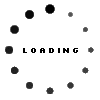N’essuie jamais de larmes sans gants : un requiem finement orchestré qui fait œuvre de mémoire

N’essuie jamais de larmes sans gants : un requiem finement orchestré qui fait œuvre de mémoire
Le Théâtre du Trident fait œuvre de mémoire en cette fin d’hiver en présentant la production, N’essuie jamais de larmes sans gants, d’après le roman de l’écrivain, dramaturge et scénariste suédois Jonas Gardell, adapté pour la scène par Véronique Côté, comédienne autrice et metteure en scène de Québec. La pièce retrace, à travers les péripéties des membres d’une petite cellule gaie de Stockholm, les débuts du sida. Alors que cette nouvelle infection mortelle se répand à une vitesse folle et touche prioritairement les communautés homosexuelles, la société cherche des coupables et impute à ces communautés l’apparition du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et la progression de l’étrange maladie qu’elle génère, au lieu d’explorer des moyens de protéger et d’aider les personnes les plus exposées.
À l’aube des années 1980, Rasmus (Olivier Artaud), un jeune homme de 19 ans, quitte la tranquillité et l’uniformité de sa petite ville de province pour apprivoiser enfin sa vie dans la fougueuse capitale. Il y fait la rencontre de Benjamin (Maxime Beauregard-Martin), un témoin de Jéhovah inexpérimenté, tiraillé entre ses pulsions et les impératifs de sa religion. Ces deux êtres que tout semble éloigner sont réunis dans le cadre des festivités de Noël organisées par Paul (Maxime Robin), un épicurien excentrique, provocant et sensuel, qui recueille chez lui les oiseaux tombés du nid.
Bien qu’ils diffèrent les uns des autres, les fidèles comparses qui gravitent autour de Paul sont liés par une profonde amitié inconditionnelle. Bengt (Gabriel Cloutier Tremblay) étudie en théâtre et s’avère particulièrement doué en la matière. Il se suicide alors que sa carrière prend son envol, incapable d’assumer sa séropositivité. Seppo (Laurent Fecteau-Nadeau) et Lars-Åke (Israël Gamache) forment un couple uni et militant. Ce dernier succombe de la maladie après de longues années de souffrance. Finalement, Reine (Samuel La Rochelle), l’amoureux transi et timide du groupe, qui peine à trouver l’âme sœur, décède le premier. Son fantôme, qui déambule en slip au sein du collectif, saisit le microphone du narrateur en premier pour commenter et enrichir le récit.
En faisant revivre les disparus qui viennent, tour à tour, narrer l’histoire, Véronique Côté a réussi à transposer l’espace textuel du roman dans l’espace scénique en un maillage qui ajoute une couche de poésie à l’acte dramaturgique. La mise en scène d’Alexandre Fecteau rend ces interventions fluides et indispensables à la compréhension des motivations profondes des personnages. Elle humanise ce qui d’emblée apparaît inhumain. De plus, la présence à l’arrière-plan d’un quatuor à cordes — piano (Anne-Marie Bernard), violon (Jean-François Gagné), alto (Karina Laliberté) et violoncelle (Mari-Loup Cottinet) —, qui ponctue le rythme des épisodes, intensifie les sentiments. Ce petit orchestre de chambre suscite respect et réflexion là où ne pourraient subsister que colère et indignation.

La scénographie (Ariane Sauvé) est à la fois simple et complexe. Elle est constituée d’un ensemble de coffres rectangulaires de différentes tailles qui rappellent des caveaux funéraires. Ces blocs sont maniés par les interprètes et agencés au gré des lieux et des actions à représenter. Mais l’élément le plus prégnant du décor est l’eau qui se manifeste comme un protagoniste dans cette histoire. Une fine pluie tombe des cintres, suintant d’abord au goutte-à-goutte, comme un patient sous perfusion, lorsque Rasmus dévoile son homosexualité à ses proches. Puis, elle s’écoule de plus en plus intensément à l’approche de l’entracte, pour en arriver à inonder complètement le plateau, avec tous les risques que cela comporte. Cette pluie incarne la propagation de la maladie ainsi que son caractère inéluctable. Le sida multiplie ses attaques et envahit progressivement le paysage en éclaboussant tout le monde sans exception. Dans la seconde moitié de la production, les personnages évoluent carrément dans l’eau. Bien qu’elle ait cessé de tomber, elle reste omniprésente. On ne peut ni l’éviter ni l’ignorer.
Sur le plan du jeu, le spectacle regorge de moments troublants, parfois cocasses, parfois tragiques, parfois osés, parfois tendres, mais qui, souvent, remuent le cœur. Les prestations de Maxime Robin, Olivier Artaud et Maxime Beauregard-Martin sont sincères et touchantes, bien que de différentes amplitudes. Dans l’ensemble, l’interprétation est impeccable à tous points de vue. Les personnages sont endossés avec nuances et même les rôles ingrats des parents de Rasmus (Hugues Frenette et Érika Gagnon) et de Benjamin (Jonathan Gagnon et Frédérique Bradet) sont rendus avec beaucoup de doigté et d’amour. La douleur et le déchirement de ces êtres face à leurs propres incompréhension et intransigeance, voire leur hypocrisie, percent au travers de leur physionomie et de leur gestuelle.
Conçu en coproduction avec le Collectif Nous sommes ici, N’essuie jamais de larmes sans gants est un requiem finement orchestré qui rappelle avec sensibilité les années troubles de l’émergence du sida et ses retombées funestes sur les communautés homosexuelles. Le VIH a braqué les projecteurs sur ces collectivités qui se sont retrouvées sous les feux de la rampe à devoir défendre, bec et ongles, leur droit d’exister. Est-ce que cette pandémie a permis aux personnes LGBTQ d’être mieux comprises et considérées aujourd’hui ? On peut se poser la question, car comme plusieurs grands mouvements de libération, leur reconnaissance et leur désir de légitimité ont commencé dans la résistance et l’adversité.
N’essuie jamais de larmes sans gants au Théâtre du Trident du 7 mars au 1er avril 2023
Crédit photo Stéphane Bourgeois