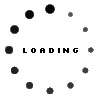Avignon – Jardin, guerre et architecture
Par Daphné Bathalon
Aujourd’hui, c’est du sérieux : je vois du théâtre pour enfants, et de la marionnette par-dessus le marché! Et en soirée, je boucle avec quelque chose de costaud, une réflexion sur l’art et l’individu à travers l’histoire de deux architectes…
Au quatrième jour
Mercredi 16 juillet 2014
On est peut-être à Avignon, mais on voyage beaucoup grâce aux productions originaires d’un peu partout en France (dommage par contre qu’il y ait si peu de productions étrangères au OFF). Cette fois, je vais me balader du côté de la Picardie. Alléchée par le programme moussé par le Conseil régional de Picardie, j’ai opté pour deux spectacles pour la jeunesse: Le jardinier et Moi qui marche. Deux pièces qui traitent de manières très différentes de l’enfant qui grandit.
D’abord, au Chapeau d’Ébène Théâtre, j’ai vu Le jardinier, de Mike Kenny. Sans cérémonie, on s’invite dans le jardin du jardinier, où le petit Joe, cette année-là, apprend à jardiner avec l’oncle Harry en regardant pousser les haricots. Printemps, été, automne, hiver, au fil des saisons, il apprendra aussi à se montrer patient, attentif et compréhensif envers sa petite soeur qu’il surnomme Gros bébé face de pruneau, car quand on jardine, tout prend du temps.
« Chaque saison abrite en elle les autres saisons. Et les vieilles gens abritent une jeune personne au plus profond d’eux-mêmes, quand les jeunes gens sont parfois plus vieux qu’ils ne paraissent. »

Seul en scène, le comédien Brice Coupey incarne tour à tour l’oncle Harry et le jeune Joe, le vieux haricot à la mémoire défaillante et la jeune pousse en colère. Coupey fait véritablement vivre le jardin : l’épouvantail, la pluie, les outils, les mauvaises herbes et le soleil. On s’y croirait. Il fait également vivre avec beaucoup de tendresse les deux personnages au coeur de l’histoire. Son jardinier porte un chapeau et parle d’une voix rauque alors que son apprenti est représenté par des petites bottes de pluie jaunes et une voix jeune débordant d’énergie. Le vieux et l’enfant discutent comme des amis, du jardin, des limaces, mais aussi de petites soeurs et de mémoire, des mots qui nous échappent et des années qui filent.

La petite scène octogonale recèle elle-même mille et une surprises au fil du temps et des saisons qui passent. Avec un arrosoir et un parapluie, on évoque ainsi les jours de pluie, une fenêtre givrée donne naissance à un très beau moment de poésie au coeur de l’hiver, tandis qu’un tiroir rempli de terre fait très bien office de plate-bande où semer des haricots… Ce spectacle inventif de la Compagnie de l’Arcade suscite l’émerveillement chez les petits comme les grands, mais sait aussi faire vibrer la corde sensible en explorant cette relation unique entre un homme, en hiver, et un enfant, au printemps de sa vie.

Le second spectacle, Moi qui marche, de la compagnie Isis, a été créé il y a dix ans, mais demeure, hélas, toujours cruellement d’actualité. La pièce se penche sur le sort des enfants meurtris par la violence, la guerre, la mort, sur ceux qui semblent « aller bien » à l’extérieur, mais qui sont ravagés à l’intérieur.
Un petit garçon nommé Floriné ressent une grande tristesse depuis la mort de ses parents dans une guerre qui n’a ni de nom ni de pays. D’abord vide à l’intérieur, il reprend peu à peu goût à la vie grâce à la patience et à l’ingéniosité d’un bricoleur excentrique qui fait pousser les fleurs aussi bien que planer les cerfs-volants.
La très belle marionnette de Floriné, aux grands yeux tristes et au petit bonnet vert, semble si frêle qu’un souffle de vent pourrait l’envoyer valser au loin. Ses manipulateurs lui insufflent en plus la fragilité de l’équilibriste. Floriné n’a en effet plus d’ancrage dans la vie, et la mise en scène tout en douceur de Jean-Paul Denizon nous fait progresser à petits pas dans la vie de cet attachant garçon. Aux côtés de celui-ci, le vieux voyageur bricoleur est l’ami que l’on aimerait tous avoir: curieux, protecteur, plein d’empathie et désireux surtout de voir son jeune ami s’épanouir à nouveau. Il tire des merveilles de son drôle d’atelier à roulettes qui roule et pétarade, au grand plaisir des enfants.
Presque sans paroles, la pièce en dit pourtant beaucoup aux jeunes spectateurs attentifs : elle parle de solitude, de deuil, d’espoir aussi, d’amitié et de reconstruction. Traitant d’un sujet aussi sérieux que la survie après la guerre, Moi qui marche aurait pu être lourd et moralisateur, mais, au contraire, c’est un spectacle lumineux qui ouvre les horizons et rend léger comme une plume. Comme Floriné et son nouvel ami, nous avons envie de chantonner à notre tour : « Nous qui marche… ».

De retour au IN, je suis allée voir le spectacle dont parlent tous les médias The fountainhead (La source vive en français), mis en scène par Ivo Van Hove (ceux et celles qui fréquentent le Festival TransAmériques se rappelleront de son éblouissant travail avec Tragédies romaines, en 2010). Il s’en dit que le spectacle ressort de la programmation plus classique et conservatrice du directeur du Festival, Olivier Py. N’ayant vu que trois spectacles de la programmation du IN, je ne saurais en juger, mais assurément, le spectacle en provenance d’Amsterdam ébranle les conventions. The fountainhead dure quatre heures, quatre heures qu’on ne voit pas filer (sinon par l’inconfort des sièges), tant la mise en scène d’Ivo Van Hove est maîtrisée et d’une précision clinique.
Adaptée du roman d’Ayn Rand, écrit en 1943, The fountainhead s’intéresse à la vie de deux jeunes architectes tout juste sortis de l’école à New York dans les années 1920. Tous deux sont également ambitieux, mais c’est bien là leur seul point commun. Si le premier, Peter Keating, est un architecte au talent honnête, mais qui a le don de savoir plaire aux gens, le second, Howard Roark, est un artiste intransigeant, un génie de l’architecture incapable de la moindre concession, ni pour ses patrons ou ses clients, ni pour le peuple envers lequel, selon son entourage, il serait redevable. Aucun des deux hommes n’est foncièrement sympathique, mais le déroulement de leur existence, qu’on suit à la manière d’une série télé riche en rebondissements, nous captive. Tant les deux architectes que les personnages qui les entourent, dont la sensuelle Dominique Francon, fille du patron d’un grand bureau d’architectes, sont des êtres torturés, complexes et sûrs de leur valeur dans le monde. Ils sont incarnés avec talent par une distribution éclatante, à commencer par le comédien Ramsey Nasr en Roark, purement éblouissant de force brute.

Sur l’immense plateau de jeu installé dans la cour du lycée Saint-Joseph, des tables à dessin, des plans, une régie et des instruments de musique. Toute la quincaillerie scénique y est déballée, visible. Le plateau, si grand qu’il paraît nu, est le théâtre des amours, des passions et des crises de conscience des personnages, de leurs moments d’élévation comme de leurs chutes, de plus en plus brutales. La mise en scène très cinématographique de Van Hove accorde une grande place aux détails, soulignés par des gros plans de caméras installées à quelques endroits sur scène. Il est dommage que la barrière de la langue (la pièce est jouée en néerlandais surtitré en français) empêche le spectateur de capter tous les détails du jeu. Les yeux collés aux surtitres, on manque forcément quelques éléments.
À une époque où, plus que jamais, la société est tiraillée entre le droit individuel et la responsabilité collective; où les gouvernements penchent de plus en plus vers la droite, plus portés à encourager l’individu à faire sa propre fortune; dans un milieu, le milieu artistique, en général plus à gauche, la position défendue par Roark va certainement à contre-courant. Alors que dans le roman, l’auteure prend de haut la conception du monde de Roark, Van Hove cherche plutôt à la mettre en perspective en abordant de front la question du rôle de l’art et des devoirs de l’artiste dans la société. Le créateur sert-il la société ou vit-il avant tout pour lui-même? Une oeuvre appartient-elle pour toujours à son créateur? L’artiste a-t-il tous les droits de détruire son oeuvre? A-t-il le devoir de la détruire s’il la juge dénaturée ou pervertie par le monde? Et la société, elle, a-t-elle le devoir de se débarrasser d’hommes comme Roark?
Mon aventure à Avignon se poursuit demain, plus que deux jours dans cette foire théâtrale!