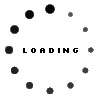Avignon : Jour 2 – Le théâtre est mort, vive le foot!

DAPHNÉ À AVIGNON – PARTIE 2
Suivez notre collègue Daphné Bathalon dans son périple à Avignon, centre névralgique du théâtre en Europe durant la saison estivale !
Dimanche 15 juillet 2018
Jamais la rue de la République n’aura été si agréable à remonter. Rues désertes, disparition des artistes aux tracts envahissants, le chant des cigales reprend même son droit de cité dans la ville. Le festival continuel est annulé, mesdames et messieurs!
 Le temps s’est suspendu aux mouvements d’un ballon.
Le temps s’est suspendu aux mouvements d’un ballon.
« Allez les Bleus! » crient les festivaliers à l’unisson, spectateurs du IN et du OFF pour une fois réunis sous une seule bannière, un seul drapeau. Tandis que la finale de la Coupe du monde interrompt momentanément la course folle d’Avignon, les salles climatisées des théâtres de la ville sont abandonnées au profit des terrasses pourvues d’écran (géant ou minuscule). Les rues s’assagissent au fil de la journée.
Dès 13h35, je sens frémir un souffle d’excitation alors que je traverse à pleine vitesse toute la vieille ville pour me rendre à un théâtre à la billetterie injoignable par téléphone (les joies du Off…). Le titre et la prémisse de Jamais jamais, une adaptation libre de Peter Pan, m’ont suffisamment intriguée pour que je tente ma chance, surtout qu’un autre spectacle au même théâtre pique mon intérêt : Nous voir nous, d’un certain Guillaume Corbeil. De quelle manière une compagnie française fait-elle sien le propos décapant de Cinq visages pour Camille Brunelle ? La proposition sera-t-elle bien différente de la mise en scène marquante de Claude Poissant ?
Mais avant, j’entame mon parcours OFF avec un spectacle jeune public, question de changer le goût laissé en bouche par les crimes abjects d’Atrée dans Thyeste.
JAMAIS JAMAIS [PETER PAN]
Compagnie Les arpenteurs de l’invisible

Ne pas parler, ne pas courir dans les allées, ne pas tousser, ne pas rire… la liste des choses interdites est si longue qu’on ne peut pas s’empêcher de pouffer… mais juste un peu! Car on ne voudrait pas s’exposer à une punition dans ce dortoir parfaitement ordonné, où cinq «adulenfants» vivent au rythme d’un timbre sonore. C’est l’heure de jouer, c’est l’heure de ranger, c’est l’heure de se coucher, c’est l’heure de dormir… et puis non! L’un des pensionnaires se rebelle: il refuse de dormir, refuse de grandir, se déclare Peter Pan et prend son envol, entraînant les autres (et nous avec) à sa suite.
Avec leur adaptation de l’oeuvre la plus célèbre de J.M. Barrie, Peter Pan, Florian Goetz et Jérémie Sonntag, qui cosignent la mise en scène, portent un regard tendre sur une aventure féérique où il suffit de croire en ses désirs pour qu’ils se réalisent. Alors que notre imagination d’adulte souffre au quotidien, alourdie d’un trop-plein de malheurs dans le monde, la production des Arpenteurs de l’invisible invoque les contours magiques du Pays du Jamais-Jamais et convoque les pirates pour les remettre à leur place.
L’île, si bien connue de tous, se peuple au fil de la description qu’en font les personnages, tour à tour joueurs, boudeurs, malicieux ou affectueux. À l’inverse de Tinker Bell, la Fée Clochette, si petite qu’elle ne peut contenir qu’une émotion à la fois, ces personnages semblent pris dans un tourbillon perpétuel d’émotions conflictuelles, qui sont tantôt joliment mises en musique, tantôt transposée dans le jeu de rôles et les histoires.
Si le spectacle plonge le jeune public dans le monde merveilleux de l’île peuplée de pirates, de sirènes, d’Indiens et d’un crocodile au son caractéristique, il ne dissimule pas pour autant les rouages théâtraux. Les lits roulent et s’emboitent sous nos yeux, ils deviennent aussi bien repaire pour garçons perdus que bateau de pirates. Sur scène, les objets du dortoir se transforment en accessoires de théâtre ou en éléments de costume pour donner vie à la vile (oui, oui, une femme) Capitaine Crochet, à son lieutenant, à Lily la tigresse, à Wendy, John et Michael…
La production offre un heureux mélange de genres, tantôt rockant Peter Pan à la guitare, tantôt l’envoyant magiquement voler dans les airs grâce à de très belles animations vidéo et à des jeux d’ombre (dont la très reconnaissable silhouette de Peter Pan). Le tout dans un ensemble cohérent et fluide qui renvoie à la fantaisie des enfants autant qu’à la souffrance profonde qui parfois les habite.

Jamais jamais! n’évite d’ailleurs pas les sujets plus sensibles abordés par l’auteur (et souvent évacués des adaptations du roman). À travers la figure de Crochet, ce sont l’obsession du temps qui passe et la peur de la mort que Barrie aborde. Avec le personnage de Wendy, la pièce interroge les stéréotypes concernant le rôle de la femme et de la mère. Peter Pan (touchant et attachant Florian Goetz) n’est pas exempt de cruauté dans son affection profonde pour la liberté et son refus du conformisme. Sous couvert du jeu et de l’enfance, Jamais jamais! suscite ainsi réflexions et émotions tant chez les enfants que les adultes, à qui la production offre d’autres niveaux de lecture.
En à peine plus d’une heure, les cinq interprètes parviennent avec beaucoup de talent et d’énergie à exposer un monde d’enfance perdue, un monde en manque de câlins et d’histoires. Ils nous invitent, d’abord avec hésitation puis de plus en plus joyeusement, ou même furieusement, à mettre de côté les règles et à activer notre imagination. Les murs du théâtre tombent, et on s’évade avec Peter Pan et ses amis entre réel et fiction pour une envolée très réussie.
***
En ressortant du théâtre, je constate que le match est sur le point de commencer. N’est-ce pas un coup de sifflet que j’entends là? Tout Avignon a les yeux rivés sur la même scène. Le silence n’est perturbé que par d’occasionnelles explosions de joie ou de protestation selon que le ballon rond trouve le fond du bon filet ou que les décisions de l’arbitre irritent ou satisfont les spectateurs.

Quant à moi, j’ai l’impression d’être de nouveau l’extraterrestre qui s’intéresse au théâtre alors que tout le monde préfère le sport. Je marche à pas pressés derrière des dos tournés, des visages attentifs, excités, confiants ou inquiets. Nous serons moins de dix à 18h pour Nous voir nous.
NOUS VOIR NOUS
Compagnie Thec, coproduction La Rose des vents

Poussée par la curiosité de découvrir un texte québécois mis en scène et adapté par une compagnie française, je suis entrée au Gilgamesh Belleville, un nouvel espace de création à Avignon. Ironiquement, c’est aussi à Avignon que j’avais finalement pu voir la version originale il y quatre ans alors que le Théâtre PàP était venu la présenter à La Manufacture.
Les légères modifications au texte de Guillaume Corbeil ne tardent pas à se faire entendre, bien sûr, avec la succession de « J’aime » qui sert de présentation aux personnages, les marques, les références musicales et cinématographiques. Les changements sont aussi perceptibles dans la surenchère de « J’ai vu », dans laquelle, on voit tout de même poindre quelques noms québécois de temps à autre, entre Mouawad («J’ai VU Incendies, Littoral et Forêt montés par Wajdi Mouawad»), Blais, Marleau et Lepage.
Le jeu des différences s’arrête néanmoins là, car que ce soit le fruit du hasard, l’influence de l’écriture syncopée de Corbeil ou autre chose, la mise en scène d’Antoine Lemaire rappelle beaucoup celle de Claude Poissant. Rapport frontal entre acteurs et public, personnages s’adressant directement à la salle ou se parlant les uns aux autres sans vraiment se regarder ni se toucher, et élément le plus évident : multiples panneaux en fond de scène qui servent autant à isoler les personnages qu’à projeter les images de la soirée dite mémorable qu’ils nous racontent.
Le spectacle souffre de la comparaison avec l’esthétisme aux couleurs vives de Poissant et l’interprétation rythmée de la distribution d’origine. Si on l’a vue, difficile de s’en détacher. La proposition de Lemaire n’en reste pas moins intéressante puisque les propos de l’auteur demeurent pertinents. Nos vies virtuelles gagnent en importance, et la façon que l’on a de se mettre soi-même en scène sur les réseaux sociaux, dans une surexposition constante, fait plus en plus de nous des acteurs en représentation perpétuelle. Tout semble devenir un simple décor pour la mise en scène de nos égos, et Lemaire et ses comédiens en ont bien saisi l’essence.
Le rythme est néanmoins bon, les personnalités bien dessinées, les images qui accompagnent les récits et divagations s’enchaînent bien, malgré quelques inversions dans les textes ou les photos le soir de la représentation du 15 juillet. J’aurais tout de même plus apprécié la proposition si elle avait présenté une lecture plus personnelle et une interprétation qui fasse contrepoids aux paroles creuses des protagonistes, à la solitude qui s’immisce dans leurs vies si parfaitement mises en scène.
***
DANS LA RÉPUBLIQUE DU BONHEUR
Compagnie Satin Rose

À 21h30, louvoyant entre les fêtards qui transforment les rues en dédales de discothèques, je me glisse jusqu’à la minuscule salle du Vieux Balancier pour me confronter à l’écriture implacable du Britannique Martin Crimp avec sa pièce Dans la république du bonheur.
D’emblée, le choix assumé de l’esthétique publicitaire kitsch des années 1960 charme l’oeil. Sur scène, les personnages – la mère, le père, la grand-mère, le grand-père qui perd le fil de ses pensées, ainsi que les deux filles – partagent un repas de toc et de plastique à la faible lumière d’un sapin d’aluminium dépourvu de toute décoration et qui n’apporte aucune joie à l’ensemble. Les couleurs pastel, les paillettes, les coiffures, tout paraît faux, sonne faux.
Dans cet espace-temps non défini, coupé du monde extérieur, le repas de Noël se déroule en trois actes qui déconstruisent totalement un bonheur de façade, qui ne tient ni au poulet pas assez cuit, ni (surtout pas!) à l’amour familial.
La metteuse en scène Camille Saintagne a visiblement fait un solide travail d’analyse du texte en amont, car sa proposition épouse intelligemment la structure dramatique particulière de Crimp, ainsi que son ton satirique, tout en tirant le meilleur parti de la musique et de l’univers kitsch de Dans la république du bonheur. C’est particulièrement le cas lorsque le personnage de l’oncle Bob surgit pour régler ses comptes (ou plutôt ceux de sa femme Madeleine) et que la pièce délaisse son côté soap américain pour plonger dans un certain chaos familial. Au deuxième acte, la table disparaît en même temps que tombe toute velléité de faux-semblant. Les personnages se dépouillent de leur costume et la pièce devient chorale pour mieux nous interroger sur les notions de limites sociales, d’impératifs de bonheur et de réussite.
Saintagne ne s’embête pas de l’espace de jeu restreint et s’en sert même pour intégrer le public à la pièce, pour le rendre témoin des bassesses, névroses et angoisses de chacun. Les propos sont bien servis par la mise en scène et les chansons qui ponctuent les différents actes. Le compositeur et musicien Victor Pitoiset, toujours présent sur scène, offre de beaux contrastes entre paroles cyniques ou dépressives et ritournelles joyeuses au clavier.
Seul reproche que l’on pourra faire à la production, les huit interprètes livrent des performances inégales tout au long de la représentation, certains trouvant moins bien le ton décalé de Crimp. Le tout se place heureusement après la première partie avec l’arrivée de l’oncle Bob (irrésistiblement détestable Daniel Baldauf) et le surgissement de la haine de Madeleine. Les chorégraphies accompagnant les chansons sont néanmoins parfaitement exécutées, et par moment franchement drôles.
Dans la république du bonheur trouve un terreau fertile avec cette mise en scène convaincante, qui ne se contente pas de livrer ce texte exigeant, mais de le faire parler au-delà de ce que les personnages se disent et surtout ne se disent pas.
***
Chère Avignon, tu ressembles à une poubelle en cette soirée post-victoire des Bleus en finale. Déjà que tu n’es pas toujours bien mise malgré tes belles pierres et tes jolies dalles, cette fois tu te laisses franchement aller. Entre bouteilles de toutes sortes, drapeaux tricolores oubliés et restants de snacks, tu as triste mine. Le lendemain de veille sera difficile, surtout si on ne te laisse pas dormir de la nuit…