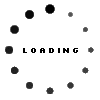L’usine : Un monde sans sens

L’usine : Un monde sans sens
Alors que les changements climatiques, la pollution, les catastrophes écologiques et le réchauffement planétaire occupent fréquemment la place publique, il est normal que ces menaces soient de plus en plus prégnantes dans les œuvres artistiques. Après le succès de leur première production, Nikki ne mourra pas (2019), la seconde création théâtrale du Collectif des sœurs Amar, L’usine, est au diapason de son époque. Dans un monde apocalyptique, Joseph (Gabriel Cloutier-Tremblay) et Joséphine (Laura Amar), deux jeunes survivants affaiblis par les affres de la maladie, du manque d’eau potable, d’aliments et de médicaments, vivent du peu d’amour, d’espoir et de souvenirs qu’il leur reste.
Le paysage défiguré de la ville, caractérisé par une fumée grise nocive et une boue orange délétère ainsi que par des débris de construction et quelques repousses faméliques de végétaux, compose l’essentiel de leur univers. L’usine maudite qui incarne la cause de leur malheur est, par la magie du texte, de la scénographie et de l’environnement sonore, omniprésente dans leur sphère. Bien que la désolation et la dévastation constituent le quotidien des protagonistes, il se dégage de l’ensemble de l’œuvre une belle poésie. Belle dans le sens d’authentique, de délicate, d’enveloppante.
Tout ce qui donne un but à la vie s’amenuise dans l’espace de L’usine. Le passé et le futur façonnent un amalgame informe qui vole en éclats. Même les personnages sont divisés ou doublés selon la perspective avec laquelle on les regarde : Joseph est également interprété par Léa Ratycz Légaré et Joséphine par Jean-François Duke. Joseph et Joséphine sont « iels », leurs alter ego les complètent et les éparpillent tout à la fois dans un ballet aux allures surréalistes. Ces doublons, homme/femme et femme/homme, agissent comme des miroirs inversés du corps et de l’âme. Elle et lui sont mouvements, là où les autres sont paroles. Elle et lui concrétisent les émotions des autres, les manœuvrent et les amplifient.
La mise en scène de Frédérique Bradet s’appuie sur la force du texte de Laura Amar et du contexte entourant son récit. Elle accorde une place prépondérante à la figure de l’usine qui s’impose par le biais des éclairages et du décor postindustriel de Louis-Robert Bouchard, mais également, et surtout, par l’intermédiaire de l’environnement sonore (Samuel Sérancour et Claude Amar) qui ponctue autant le souffle de l’histoire qu’il ventile celui du public. La bande sonore riche et symbolique de la pièce fait vibrer les spectateurs et les acteurs d’un même élan. Les costumes de Delphine Gagné complètent le tableau en accentuant la gémellité des personnages et la toxicité de leur territoire. Ceux des doubles donnent l’impression que ces êtres fantasmagoriques sont nés de la boue.
Le jeu de Laura Amar dans le rôle de la jeune femme invalide est touchant. Ses répliques sont parfois douces, parfois troubles, parfois amusantes, parfois violentes. Mais elles sont toujours justes. Amar exhale une aura de fragilité qui brille sur scène et que son jumeau Jean-François Duke enrichit de sa gestuelle et de sa chorégraphie. Le jeu de Gabriel Cloutier-Tremblay et par extension de son double, plus viril et volontaire, donne de l’ampleur à la vulnérabilité de Joséphine et met en valeur l’interprétation de sa complice scénique.
L’usine est une œuvre à la fois funeste et lumineuse. Funeste par son contexte et son propos, éco-anxieux s’abstenir, mais lumineuse par son écriture et son orchestration. Prisonniers d’un monde sans sens, les personnages, comme ceux de Samuel Beckett ou d’Eugène Ionesco, y perdent leurs repères et leurs attaches. Ils errent dans un cercle vicié au sein des décombres de leur humanité.
L’usine, au Théâtre Périscope jusqu’au 29 octobre 2022
Crédit photo Charline Clavier