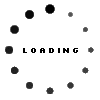Avignon dans tous ses états
Par Daphné Bathalon
Un séjour à Avignon pendant son festival est une expérience qui relève du festin gargantuesque. Insatiables, les festivaliers butinent d’un théâtre à l’autre, ne sortant d’une salle que pour se précipiter dans une autre, à peine le temps d’être éblouis par le soleil qu’ils retrouvent l’ombre du public.

Faire un choix parmi toute l’offre implique forcément de rejeter des centaines d’autres possibilités, avec le risque d’opter pour un navet et de rater une oeuvre éclatante. Qu’à cela ne tienne! Je garde le cap de ma première sélection, avec quelques ajustements en fonction des rendez-vous ratés et des salles trop pleines. C’est qu’après une semaine de représentations, les spectacles de qualité commencent à se connaître et à faire parler dans les rues et sur les terrasses… Mieux vaut réserver si on ne veut pas se retrouver le bec à l’eau, mais pas facile quand, comme moi, touriste en goguette, on n’a pas de téléphone à portée de main! Je me laisse donc bercer au gré des places libres et tente de ne pas me laisser décourager par la longueur des files qui s’étirent en plein soleil.
Au troisième jour
Mardi 15 juillet 2014
Je commence à me repérer dans Avignon sans presque avoir recours à ma carte. J’en suis assez fière, croyez-moi, car les rues de la vieille ville s’entortillent sur elles-mêmes dans un embrouillamini de dédales où il est très facile de se perdre.
 J’entame ma journée à la Chapelle des pénitents blancs, l’un des lieux de représentation du IN. Il est 11h à peine et, public de festival oblige, la file se compose davantage d’adultes que de jeunes, à qui la pièce s’adresse pourtant.
J’entame ma journée à la Chapelle des pénitents blancs, l’un des lieux de représentation du IN. Il est 11h à peine et, public de festival oblige, la file se compose davantage d’adultes que de jeunes, à qui la pièce s’adresse pourtant.
Premier opus d’une trilogie pour adolescents intitulée Visage(s) de notre jeunesse, Même les chevaliers tombent dans l’oubli raconte l’étrange histoire de George (un prénom qu’elle s’est choisi), une fille blanche de huit ans pour qui sa peau n’est pas sa vraie peau, car elle n’est pas de la bonne couleur. Le magnifique texte de Gustave Akakpo aborde de front le questionnement identitaire chez les jeunes, notamment ceux qui habitent en banlieue parisienne, dans le fameux 93 (Seine-Saint-Denis), sur la quête de leurs origines et de ce qui les définit en tant qu’êtres uniques, ce qui fait qu’ils sont d’ici plutôt que de là-bas, et du racisme.
Dans sa quête identitaire, George finit par perdre ses peaux, la blanche comme la noire, et se retrouve dans une peau de lune lumineuse que seuls les autres jeunes semblent voir. Mais « sans peau, je tombe dans l’oubli, je disparais de la mémoire des gens », constate la jeune fille. Alors elle emprunte la peau des autres, et tous se mettent à changer de peau dans la cour de l’école.
Avec Même les chevaliers tombent dans l’oubli, Matthieu Roy propose une mise en scène éclectique qui mêle dans une grande fluidité arts visuels et théâtre. Sur scène, la comédienne Gisèle Adandedjan interprète la George noire. Autour d’elle, Mamadou (Carlos Dosseh), dont elle envie la couleur de peau, et des personnages virtuels : adolescents typiques de la banlieue, capuchon sur la tête, pantalon aux genoux et argot bien marqué. Comédiens et personnages virtuels se répondent très naturellement, l’interaction est vivante, rythmée, parfaite. Mitraillées comme pour un slam, les paroles des jeunes font chaque fois mouche. Si les répliques des adolescents sont parfois difficiles à entendre, notamment en raison du vocabulaire et des accents, le metteur en scène réussit à composer avec elles une trame rythmique entraînante.

Le recours aux personnages virtuels n’a rien de très nouveau dans le monde du théâtre, mais la production de la Compagnie du Veilleur se joue admirablement bien des clairs-obscurs en scène. La vidéo, les éclairages, les ombres, la peau de lune de George… tous sont habilement maîtrisés et concourent à créer une atmosphère parfois angoissante, toujours étrange, et qui exerce une véritable fascination sur le public.
Le jeu des trois comédiens, dont celui de Charlotte van Bervesseles qui incarne la George blanche et tous les personnages d’ados, est extraordinairement précis. Car Même les chevaliers tombent dans l’oubli parle aussi le langage du corps, de ces mains qui s’agitent en rythme quand les jeunes parlent, de cette danse des épaules, de ce recroquevillement sur soi-même pour éviter le regard des autres, de ce corps adulte abêti par la fatigue ou de ces corps de lumière qui se meuvent tout en grâce… Difficile de ne pas sortir ébranlé par le propos de ce spectacle qui questionne, en même temps que notre identité, notre rapport aux autres et notre recherche constante d’acceptation dans un groupe.
 Autre spectacle qui accorde une grande place à la projection, cette fois du côté du OFF : L’homme qui rit, d’après le roman de Victor Hugo, d’ailleurs porté au grand écran en 2012 (avec le comédien Marc-André Grondin). Présenté comme un spectacle d’arts numériques, la production du Collectif 8 et du Théâtre du Chêne Noir nous invite à pénétrer dans l’univers des fêtes foraines pour découvrir l’histoire de Gwynplaine, au visage défiguré par une horrible balafre qui le force à sourire constamment.
Autre spectacle qui accorde une grande place à la projection, cette fois du côté du OFF : L’homme qui rit, d’après le roman de Victor Hugo, d’ailleurs porté au grand écran en 2012 (avec le comédien Marc-André Grondin). Présenté comme un spectacle d’arts numériques, la production du Collectif 8 et du Théâtre du Chêne Noir nous invite à pénétrer dans l’univers des fêtes foraines pour découvrir l’histoire de Gwynplaine, au visage défiguré par une horrible balafre qui le force à sourire constamment.
Le saltimbanque vit néanmoins heureux : il est aimé de Déa, une jeune aveugle de la foire. Mais son univers bascule lorsque leur roulotte s’installe à Londres et que la lumière se fait soudainement sur ses origines aristocratiques. Il devient dès lors porte-parole du peuple, réclame pour celui-ci le droit au bonheur. « Vous avez tout et ce tout se compose du rien des autres », lance-t-il aux visages hilares des Lords.

Le récit de sa vie et de sa mort tragique est d’abord magiquement porté par le comédien Paul Chariéras, dans la peau du bonimenteur et philosophe Ursus. En un rien de temps, il nous entraîne dans le monde forain, fait de mensonges et d’illusions. Tout au long du spectacle, les créations vidéo signées Paulo Correia (qui incarne également Gwynplaine) nous en mettent, pour leur part, plein les yeux. Projetées du sol au plafond, tantôt elles évoquent par des ombres le voyage des marchands d’enfants et l’abandon de Gwynplaine, tantôt elles esquissent la ville de Londres et les attractions de la foire. Loin d’alourdir la mise en scène, elles l’ouvrent sur le monde fantaisiste et factice habité par l’Homme qui rit. Elles magnifient également le plaidoyer final de Victor Hugo, qui s’exprime par la bouche de Gwynplaine, pour réclamer plus d’égalité : que l’on cesse d’enrichir les riches en appauvrissant les pauvres!
Grâce à une mise en scène lumineuse (malgré la noirceur de l’époque) et à une distribution vibrante, voire ensorceleuse, L’homme qui rit réjouit tant les sens que l’esprit.
Arts visuels et théâtre de marionnettes donnent aussi à voir une autre excellente production du OFF : L’école des ventriloques, de la compagnie belge Point Zéro. Au Théâtre de la Manufacture, dont la programmation ne déçoit pas jusqu’à présent, les pantins d’Alexandro Jodorowsky ne sont pas ceux que l’on croit…

C’est l’affiche, d’abord, qui retient notre attention. Parmi toutes celles qui s’exposent un peu partout en ville, l’affiche de L’école des ventriloques détonne par son allure sombre, quasi cauchemardesque. Et c’est bien dans un cauchemar que nous plongeons à la suite de ce pauvre homme tombé de nulle part dans ce qui s’apparente plus à un asile qu’à une école, ou alors une école de fous. Tel une Alice, l’homme vêtu d’un complet jaune découvre peu à peu les règles qui régissent ce Pays des merveilles où toutes les perversions sont encouragées. Il doit apprendre à devenir une ombre pour laisser vivre son pantin intérieur. En parallèle, les interventions vidéo de Michel Hébert suivent de manière très imagée le cauchemar mental de l’homme tandis qu’il cherche à s’adapter à son nouvel enfer.
Lubriques, vulgaires, tordues, insolentes, les marionnettes qui peuplent cet univers n’ont aucun tabou : on bat bébé Jésus pour le faire taire, on lapide un saint benêt pour l’empêcher de faire des miracles, on pousse un génie au suicide pour avoir osé se créer une âme… même les héros ne font pas long feu dans ce monde noir où, « si la loi n’est pas dure, elle n’est pas loi ».

Les marionnettes, conscientes d’être manipulées, traitent leur manipulateur en esclaves. Qui manipule qui réellement? Et qui fait la loi dans cette école? Qui est ce directeur que tout le monde craint? Le metteur en scène Jean-Michel d’Hoop s’amuse beaucoup à créer et à entretenir la confusion entre manipulateurs et manipulés, jusqu’à briser les limites de la manipulation et à franchir toutes les frontières. Sa proposition évoque tout à la fois les univers psychédéliques de Carroll, de Kafka et d’Orwell, et nous fait accepter étonnamment facilement les règles démentes qui régissent l’école des ventriloques. « Ici, c’est plus sévère qu’une prison, c’est une école », prévient d’ailleurs le gardien des lieux, le truculent Don Crispin.
Embarqué avec l’homme dans cet univers où les conventions et la réalité se dérobent constamment à son esprit, le spectateur ne sort pas indemne de cette aventure aux confins de ses propres perversions.
Dans un tout autre style, le spectacle Constellations mise sur une scénographie très lumineuse et épurée, style « boîte à chaussures ». L’important ici est le jeu tout en nuances des comédiens.

La production de la compagnie Théâtre du Prisme explore les variations possibles d’une relation amoureuse. Il est apiculteur, elle est physicienne. Tout les oppose, et pourtant… dans certains univers, leur première rencontre, fruit du hasard, les mène à développer une relation, puis à former un couple, qui affronte l’adversité. Dans certains univers, ils s’aiment malgré toutes les difficultés, dans d’autres, ils se séparent, se trompent, reviennent en couple ou ne reviennent pas… Il y a un monde où Roland et Marianne se marient et un autre où ils ne s’embrassent même pas! Dans Constellations, monté pour la première fois en France, l’auteur anglais Nick Payne se penche sur la théorie des multivers, selon laquelle chaque parole, geste et décision engendre la création d’un univers alternatif.
S’il faut un petit temps d’adaptation pour comprendre la mécanique qui régit cette production, dès lors qu’on plonge dans ces multivers, on est captivé par les détails qui font que deux êtres humains se rapprochent ou s’éloignent, se font plaisir ou se blessent. La direction d’acteurs du metteur en scène Arnaud Anckaert est incroyablement précise, chaque changement d’univers, de temps, de lieu étant suggéré par de subtiles modifications dans le jeu des comédiens Noémie Gantier et Maxence Vandevelde, parfois par de légers changements d’éclairage. De fait, cette pièce à texte repose entièrement sur la dynamique qui s’établit entre les deux comédiens, sur le rapprochement de leurs corps ou sur ce qui les sépare : trahisons, maladies, sentiments, physique quantique…
La forme fragmentaire et éclatée du récit, qui suit néanmoins une certaine progression dans le temps, intrigue puis captive : parmi toutes les erreurs possibles et tous les univers où ils ne parviennent pas à s’aimer, le couple survivra-t-il au pire? La répétition des scènes, des mots, les nuances elles-mêmes nous larguent parfois en cours de route, mais heureusement, le talent avec lequel jouent les acteurs nous ramène toujours vers l’émotion. Tantôt drôles, tantôt émouvants, ils forment le coeur de ces nombreuses et brillantes constellations.