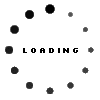Avignon partie 2 : En avant la musique

Chapitre 2 : Les retrouvailles
Par Daphné Bathalon
Qui a goûté Avignon une fois s’y replonge en un instant, et y retrouve ses marques, ses rues familières aux noms imaginatifs (des trois Testons, de la Brouette, du Four de la Terre, du Chapeau rouge, de la Grande Monnaie, de la Petite Monnaie, rue Cornue, rue Joyeuse…), ses multitudes de terrasses et ses minitrottoirs encombrés sur lesquels il faut faire preuve de l’habileté de l’équilibriste, et puis, bien sûr, le chant des cigales, assourdissant. Le plan, malgré tout, s’avère un essentiel à glisser dans sa poche. C’est quand on gagne en confiance et croit connaître les rues courbes d’Avignon que la ville des papes vous prend en traître.
Dans les rues, les artistes déploient une foule de moyens, classiques ou inusités, sobres ou flamboyants. Ça tracte à pieds, à roulettes, à bicyclette, sur les pieds ou sur les mains, en criant ou en chantant, en se dénigrant ou en faisant du charme : tous les moyens sont bons pour se démarquer dans la foule. Faire parler de soi en ce début de festival est crucial pour toutes les compagnies, qui doivent remplir les salles si elles veulent rentabiliser les dépenses (une jeune compagnie peut dépenser pas moins de 100 000 euros pour présenter un spectacle à Avignon!). Qu’elles ne s’inquiètent pas trop cependant : les théâtres sont si courus qu’obtenir la billetterie au téléphone relève parfois du parcours du combattant.
ASSOIFFÉS (Le bruit de la rouille)

La plume de l’auteur d’origine libanaise Wajdi Mouawad continue de séduire autant les Français que les Québécois. Trois de ses textes sont présentés cette année au Off, Pacamambo, Un obus dans le coeur et Assoiffés. C’est l’affiche de ce dernier, avant tout, qui a retenu mon attention, et le fait que le comédien principal est québécois. La jeune compagnie Le bruit de la rouille s’est lancée dans un ambitieux laboratoire sur l’oeuvre intégrale de Mouawad. Leur première création, Assoiffés, est la troisième étape de ce projet.
Pièce construite comme un casse-tête de souvenirs et de réflexions poétiques, Assoiffés (écrit en collaboration avec Benoît Vermeulen) nous livre peu à peu les éléments qui vont permettre à Boon, un anthropologue judiciaire et ancien aspirant auteur de génie, de lever le voile sur l’identité des deux adolescents retrouvés étroitement enlacés au fond du fleuve. C’est en découvrant que le garçon était en fait Sylvain Murdoch, disparu en 1991, que les détails du jour de cette disparition vont revenir en mémoire de Boon et le replonger dans sa quête de beauté de l’époque.
Avec ce texte, présenté presque sans interruption au Québec depuis sa création, Mouawad touche une corde sensible chez le public adolescent et jeune adulte : la quête d’un sens à la vie, la quête d’un peu de beauté et la présence de la laideur au coeur même de la beauté. Les personnages d’Assoiffés cherchent avant tout à trouver un sens à leur vie. Un matin, celui du jour de sa disparition, alors qu’il attend pour la énième fois l’autobus 121, Murdoch prend conscience de l’inanité de son existence et du cycle inébranlable des répétitions (avoir faim, manger, re-avoir faim, re-manger, re-re-avoir faim, re-re-re-manger) qui le ramènera toujours là, à attendre le 121. Parce qu’il ne sait pas comment s’y soustraire, Murdoch va alors tenter de se vider de l’intérieur par la parole, en parlant sans jamais s’arrêter.
Grâce à Alexandre Streicher, Murdoch conserve la truculence de son langage bien québécois, jurons compris (ce qui fait d’ailleurs bien réagir la salle dans les premières minutes). Les artistes ont choisi de demeurer fidèles à la langue choisie par les auteurs, même pour le personnage du narrateur (en dépit de quelques modifications mineures, de mémoire). Et c’est tant mieux, car cette langue donne un rythme précis au texte et aux personnages. Le Murdoch de Streider, au regard halluciné et à la parole intarissable, peine d’abord à trouver ce rythme. Heureusement, si son style paraît au départ inutilement outrancier, l’acteur trouve son souffle dès sa deuxième apparition, ainsi que le ton de l’insatiable et « irrassasié » Murdoch, qui s’est levé « d’un pied cannibale » ce matin de février.
À ses côtés, Viven Fedele apparaît d’abord sous l’allure grise de l’homme à la vie morne et aux rêves oubliés ; c’est le complet, dont il se défait très vite. L’adolescent rêveur en lui, Boon, s’éveille au fur et à mesure qu’il retrace les dernières heures du camarade de classe de son frère. Malgré quelques expressions québécoises incongrues dans la bouche d’un Français, le comédien s’en tire bien dans un rôle de narrateur dépassé par ces souvenirs qui ressurgissent.
La scénographie tient dans une boîte, couleur rouille, fendue en son centre par une membrane fragile, que les personnages devront déchirer pour recommencer à respirer. Cette boîte de fer, qui rappelle les conteneurs oubliés sur les quais du monde, contient le passé de Boon, l’histoire de Murdoch, celle de Norvège, une jeune fille mystérieuse, et laisse tout doucement s’installer une production tendre et sans excès, qui donne toute la place aux mots des auteurs, à une poésie dans laquelle se lovent finalement à la fois laideur et beauté.
MANGE TES RONCES (Brigand Rouge / Boîte à Clous)

L’habileté et la maîtrise des interprètes frappent d’emblée dans cette charmante production belge de théâtre d’ombres, mais surtout de lumière. Avec quelques rétroprojecteurs et le soutien sonore d’un musicien sur scène, Mange tes ronces charment en un rien de temps.
Mamie Ronce vit paisiblement en compagnie de son basset, Moquette, qui adore courir après les oiseaux et déteste les enfants. Avec son nez pointu, son regard sévère et ses poils au menton, Mamie Ronce a toutes les allures d’une vieille sorcière, et pas de doute, elle en a le rire et les manières! Mais voilà que sa fille lui confie pour quelques jours la garde de son petit-fils de six ans, qu’elle n’a pas vu depuis longtemps. De quoi ruiner son quotidien, fait de travail dans le jardin et d’un soap qu’elle suit assidument. Léopold non plus n’est pas très enchanté, lui à qui le jardin rempli de ronces fait aussi peur que cette grand-mère grincheuse et autoritaire. Derrière ses impressionnantes lunettes vertes, Mamie Ronce n’est pourtant pas aussi revêche que son patronyme le laisse entendre, si bien que, comme nous, elle craque rapidement pour son petit-fils.
La compagnie fait véritablement de la petite magie avec ses projecteurs, ses décors en papier et ses marionnettes de carton. Quelques touches de couleur viennent souligner des effets, ici et là, tandis que la manipulation à vue rend le jeune public complice de ces petits trucages virtuels. Les marionnettes de Mamie Ronce, du chien Moquette et du petit Léopold débordent de vie sur les toiles. Leurs yeux, très expressifs, en disent beaucoup, même quand le silence plane. Les marionnettes font d’ailleurs toute la beauté de cet étonnant spectacle, dont la forme cinématographique propose un découpage serré et efficace. Gros plans, plans larges, balayage, duplex, superposition et jeux de perspectives, tout y est pour nous immerger dans l’histoire. On jurerait voir un court-métrage d’animation!
S’il faut reprocher quelque chose au spectacle, c’est d’évacuer un peu rapidement les enjeux dramatiques de l’histoire, alors que la mamie, assez dure au premier abord, révèle son grand coeur et que les peurs de Léopold se dégonflent à la première cuillerée de soupe ou au premier ronflement. Le spectacle représente néanmoins une parfaite introduction à une discussion sur la peur avec son enfant.
Mange tes ronces joue en effet habilement des peurs enfantines et des chimères qu’on se raconte face à l’inconnu. Comme Léopold, on imagine très bien ce qui pourrait se terrer parmi les ronces et les orties urticantes du jardin de mamie… Comme lui aussi, on grimace à la vue de cette soupe d’ortie verte et si peu ragoûtante. Quelques scènes, comme celle des cauchemars de Léopold, impressionneront même les plus âgés!
Magnifique conte moderne, Mange tes ronces fait assurément partie de ces spectacles qu’on prend plaisir à voir plus d’une fois, à la manière des enfants qui redemandant leurs histoires préférées.
LES DAMNÉS (avec la troupe de la Comédie-Française)

Ivo Van Hove, l’un des metteurs en scène chéris du Festival d’Avignon (dont on aussi vu la production Les tradégies romaines au FTA, notamment), revient dans la ville des papes après y avoir présenté son adaptation du roman The Fountainhead, en 2014. Une production exigeante qui avait été bien accueillie tant par le public que par la critique (lire ici la critique que MonTheatre en avait fait). Cette fois, il propose sa version des Damnés, d’après le film de Luchino Visconti, et un scénario de Visconti, Nicola Badalucco et Enrico Medioli. Ce n’est pas la première fois que Van Hove monte Visconti. Après Rocco et ses frères, Ludwig, puis Les Damnés, le metteur en scène s’attaquera d’ailleurs prochainement aux Amants diaboliques.
Les damnés du titre, ce sont les membres de la très riche famille von Essenbeck, mais aussi de ceux qui gravitent dans son orbite. Les von Essenbeck ont fait fortune grâce à leur entreprise d’acier. Avec la guerre que prépare Hitler, la bonne fortune pourrait bien leur sourire, mais c’est la mort et la haine qui viendront les faucher. Comme les Atrides, ils finiront par s’entretuer : frères, fils, cousins, amants, tous s’entredéchireront sur fond de la montée du nazisme dans une Allemagne troublée, où brûlent le Reichstag, les livres, les opposants, les Juifs…
On connaît Van Hove pour ses grands plateaux, ses éclairages clairs et sans fard et sa direction d’acteurs très précise. Les Damnés trouvent dans la cour d’honneur du Palais des papes un lieu d’accueil à leur mesure. Avec le travail de son partenaire de longue date, Jan Versweyveld, à la scénographie et aux lumières, le metteur en scène propose une fresque à la fois historique (quelques images d’archives viendront d’ailleurs ponctuer les points tournants de l’histoire) et personnelle, captivante fusion de théâtre et de cinéma. Les Damnés est terrible, glaciale, implacable.

Sur le grand plateau recouvert de tuiles orangées, comme autant de braise sous laquelle couve la haine les personnages de cette histoire, les comédiens de la Comédie-Française dévoilent leur talent avec mesure et sobriété pendant la première moitié du spectacle. Didier Sandre, d’abord, dans la peau du dépassé baron von Essenbeck, mais aussi Christophe Montenez en héritier déviant et fils terrifié par sa mère. Loïc Corbery, en Herbert, trop vite exilé, insuffle à son personnage libéral tout le désespoir d’un homme qui réalise vite que « ça ne sert à rien d’élever la voix quand il est trop tard ». Guillaume Gallienne surprend pour sa part en Friedrich, un assoiffé de pouvoir, par un jeu sobre et ciselé. À ses côtés, Elsa Lepoivre est aussi terrible que magnifique en Sophie von Essenbeck.
Deux caméras vont chercher l’émotion sous-jacente sur leur visage ou dans leur corps, mais aussi les tensions et les rapprochements, tantôt passionnés, tantôt animés par l’ambition. C’est par elles aussi, et les images qu’elles captent en coulisse, côté jardin de la scène, que le metteur en scène nous présente les personnages de cette histoire qui commence en février 1933, du patriarche entêté au fils SA, au petits-fils et héritier troublant, amoral, en passant par la veuve du défunt fils von Essenbeck et par le cousin et le vice-président de la compagnie, que l’on cherche, dans l’ombre, à se débarrasser parce qu’ouvertement anti-Hitler. Par gros plans ou en suivant les interactions entre eux, le metteur en scène se fait réalisateur et place dès le départ les bases de ce qui est voué à se produire. Passé les premières minutes, le procédé cinématographique s’épuise légèrement à force de ne présenter que directement ce qui se déroule sur scène, mais regagne en puissance en deuxième moitié de spectacle, grâce à d’habiles manipulations de l’image et à des cadrages qui nous donnent des points de vue différents sur les scènes, un procédé maîtrisé par Van Hove. La scène de repos des SA est effroyable. Autre rituel : celui de la mort, où les personnages viennent se placer comme des soldats sur le plateau tandis que le défunt est couché dans un cercueil, puis que son agonie est projetée sur grand écran. Des séquences difficiles qu’un voisin de siège préférait masquer d’une main.
Les Damnés trouble en effet, plus d’une fois. Par la violence des actions posées par les personnages, par la douleur de la mort, par les relations froides, déviantes et amorales (mais si peu souvent véritablement intimes et honnêtes) entretenues par les personnages. Le public de la Cour d’honneur retient son souffle pendant une bonne partie de ce spectacle de deux heures. La marche de l’histoire autant la grande que celle de cette famille est en marche, et de funeste manière.

Van Hove n’épargne ni ses acteurs ni le public, avec des tableaux grandioses et puissants. À ce titre, et sans rien en révéler, la scène finale est une de ces images qui restent imprimées longtemps sur la rétine et plongent les spectateurs dans un état d’effroi rarement éprouvé au théâtre, de quoi glacer le sang, même lorsqu’on se croit immunisé à l’horreur à force de voir les images choquantes diffusées en boucle dans les médias. Car la haine des Nazis n’a pas disparu, elle a muté et se glisse au coeur même de la jeunesse actuelle.
Avec cette nouvelle production, Van Hove a réduit au silence la Cour d’honneur avant de l’unir dans un souffle d’applaudissements.
On peut visionner le spectacle sur le site Culturebox jusqu’en janvier 2017 en cliquant ici.