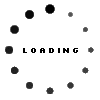(CRITIQUE) National Theatre Live – Variations modernes

par Daphné Bathalon
Cineplex et ses partenaires du National Theatre Live, du Almeida Live et de Stratford on stage) nous gâtent cette saison 2016-2017 avec une programmation très variée alternant classiques et textes contemporains, tragédies et comédies, spectacles plus intimistes ou à grand déploiement. Entre mars et juillet, le public pourra apprécier du Ibsen, du Kushner, du Shaw et des classiques revisités, notamment Salomé et un Twelfth Night, loin de la cour royale.
AMADEUS
Cet hiver, le NT Live proposait une nouvelle mise en scène d’Amadeus, sur la scène même où ce spectacle de Peter Shaffer avait été créé en 1979. La production était présentée sur grand écran en janvier et en mars, notamment au Cineplex Forum.
Pas facile de s’attaquer au texte d’Amadeus, quand son adaptation au cinéma a marqué les esprits et remporté plus de 40 prix dans le monde depuis sa sortie en 1984. La pièce a tout de même été montée maintes fois, dont par René Richard Cyr chez DUCEPPE en 2009.

Le metteur en scène de la production du National Theatre, Michael Longhurst, a fait le pari d’accorder une large place à la musique en tirant l’orchestre de sa fosse pour le placer directement sur scène et le mettre en lumière. Les musiciens y jouent par moment les membres de la cour, le public ou, littéralement, les musiciens. Autrement dit, l’orchestre devient un membre à part entière de la distribution et s’intègre à l’histoire. Un choix artistique qui donne non seulement une couleur particulière à l’ensemble, mais permet, aux côtés du personnage central, de découvrir les textures et la richesse de la musique composée par Mozart.
L’histoire imaginée par Shaffer donne la parole à Antonio Salieri, compositeur italien à la cour de l’empereur autrichien Joseph II. Jadis réputé et louangé, il n’est plus, en 1823, qu’un vieil homme aigri et oublié de presque tous. Déterminé à ne pas sombrer totalement dans l’oubli, il s’accuse d’être responsable de la mort du jeune compositeur prodige, Wolfgang Amadeus Mozart. Salieri replonge avec nous dans ses souvenirs, son enfance, où dans un moment de grâce, il jura à Dieu de demeurer vertueux en échange d’une gloire éternelle, à l’arrivée à la cour de Mozart, qu’il voit comme une menace et se jure d’évincer par tous les moyens.

En Salieri, Lucian Msamati fait des merveilles. Son interprétation du compositeur plein de jalousie inscrit tout en nuance le combat qu’il mène contre Dieu à travers Mozart. Car Salieri n’en veut pas au jeune compositeur, dont il apprécie au contraire (jusqu’à souffrir de plaisir) le génie musical, c’est ultimement Dieu qu’il met au défi en s’attaquant à celui qu’il croit être l’élu divin. Msamati aurait pu verser dans la démesure, jouer les vilains (après tout, il a le mauvais rôle dans cette histoire), mais alors que Salieri met en application son plan machiavélique pour détruire son rival, son interprète le fait en superposant de nombreuses couches d’émotion : de l’émerveillement musical à l’exaspération devant les frasques de Mozart, en passant par la jalousie pure, la gloutonnerie et la culpabilité. Face à cette composition, l’incarnation exubérante que nous sert Adam Gillen, à la chevelure javellisée et aux rutilants Doc Martens noir et or, n’en est que plus grinçante. On pourra regretter l’intensité de cette interprétation, tout en cris, en grimaces et en flatulences, parfois insupportable, mais il faut reconnaître qu’elle souligne merveilleusement l’irritation que Mozart suscite dans son entourage. Un peu moins de cris et de grimaces auraient néanmoins donné plus de subtilité au personnage. Heureusement, l’émotion et la vulnérabilité ressurgissent dans la scène crève-cœur où Mozart puise dans ses ultimes ressources pour composer son requiem.
Cette production, que l’auteur, décédé en juin 2016, n’aura malheureusement pas pu voir, a le (grand) mérite de placer en son centre la beauté de la musique et de la magnifier par une interprétation sur scène plutôt que sur bandes préenregistrées. À écouter à pleines oreilles.
HEDDA GABLER
Quand on pense Henrik Ibsen, les premiers titres à venir à l’esprit sont souvent Une maison de poupée et… Hedda Gabler, sulfureuse et insaisissable Hedda. Couplée au nom du metteur en scène de l’heure Ivo Van Hove, la production du National Theatre a de quoi susciter la curiosité.
Dans le rôle-titre, on retrouve une actrice déjà reconnue pour un autre rôle incandescent, celui de la némésis de Luther dans la série britannique du même nom, mettant en vedette Idris Elba. Ruth Wilson est admirable en Hedda, il faut le souligner et plus d’une fois. C’est sur ses épaules que repose entièrement la production, alors qu’elle paraît pourtant toute petite dans un décor d’appartement aussi grand que vide. Loin d’écraser la silhouette de l’actrice dans son peignoir satiné, le décor la sublime. On est en effet bien loin du lourd apparat du décor victorien, époque à laquelle se situait la pièce d’Ibsen. La mise en scène de Van Hove resitue l’action dans un appartement moderne et riche (la présence d’une bonne attitrée presque exclusivement à l’accueil des invités donne le ton), mais où l’ennui existentialiste d’Hedda n’est pas moins lourd et mortifère.

Car Hedda s’ennuie. Son mari l’ennuie, ses amants l’ennuie, une « amie » l’ennuie, bref, elle se traîne sans conviction d’un bout à l’autre de l’appartement, fait disparaître le jour derrière des stores latéraux dont les ombres s’étalent tels des barreaux de prison sur l’un des hauts murs de l’appartement. Ces murs paraissent eux-mêmes en mal de direction, nus de tout ornement ou peinture. L’interprétation de Wilson nous donne à voir les montagnes russes émotionnelles que traverse Hedda tandis que les heures s’étirent; un instant apparaissant presque contemplative ou même triste, l’instant suivant débordant d’une colère physique et hors de contrôle. Mais c’est l’ennui qui domine, et par ennui que Hedda manipule tous et toutes autour d’elle, comme si elle cherchait à les rabaisser à son niveau.

Autour de cette inhabituelle figure de l’antihéroïne (beaucoup moins répandue que sa contrepartie masculine), les autres personnages font pâle figure. Par comparaison, leur interprétation paraît par moments manquer de souffle, à l’exception de celle de Rafe Spall dans le rôle du juge Brack. La scène finale, où il démontre à Hedda à quel point elle ne peut se soustraire à son emprise, est à glacer le sang. Fort d’une telle qualité de jeu et d’une adaptation finement ciselée par l’auteur Patrick Marber, on se demande néanmoins quel était l’objectif de Van Hove en venant artificiellement plaquer des musiques plus pop sur l’ensemble, brisant à quelques reprises la tension d’une scène.
Dépoussiérée de son époque victorienne, Hedda Gabler, dans la proposition menée par Van Hove, rappelle que même en cette ère de divorce à la minute, existent toujours des Hedda, prises au piège d’un mariage sans amour et d’une vie dénuée de sens.
Dernière représentation de Hedda Gabler le 1er avril 2017, 15h