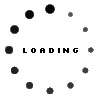Avignon partie 5 : Incursion au IN

Chapitre cinq : Le rythme
Par Daphné Bathalon
À partir du troisième jour, le festivalier moyen adopte un rythme qu’on pourrait qualifier « de croisière » et qui tourne en général autour de trois ou quatre spectacles par jour. Les plus enthousiastes peuvent en voir jusqu’à cinq ou six dans une journée, mais il faut décidément avoir une digestion rapide ou un très grand appétit! Pour ma part, je ne maîtrise pas encore l’art de la consommation express, je m’en tiens donc à trois spectacles quotidiens, ce qui occupe déjà bien mes journées (!), il faut après tout aussi s’arrêter pour goûter aux nombreuses terrasses d’Avignon, surtout quand le temps est doux et clément.
Le mistral souffle toujours et même de plus en plus fort, au point où les piétons doivent faire attention aux PVNI (pancartes volantes non identifiées). La plupart des compagnies se rabattent sur les tracts. Mais aujourd’hui, je me suis tenue loin du Off puisque trois spectacles du Festival d’Avignon étaient à mon horaire.
Depuis son arrivée à la direction du festival, Olivier Py accorde une belle place au théâtre jeune public, notamment à la Chapelle des Pénitents Blancs. J’y avais vu, en 2014, Même les chevaliers tombent dans l’oubli, sur des jeunes mal dans leur peau. J’y allais cette fois voir Truckstop, un polar pour ados, mais pas que.
TRUCKSTOP (La Comédie de Saint-Étienne et La Comédie de Béthune)

Sur une route de campagne d’une région agricole de la France, un relais routier désuet, gris, aux fenêtres duquel pendent des rideaux au crochet, résiste. Une mère et sa fille de 18 ans, Katalijne, qui souffre de TDAH, tiennent ce casse-croûte fixé dans le temps et qui n’accueille plus que quelques rares clients. Remko, un jeune camionneur malchanceux, s’y arrête presque tous les jours pour boire un café ou grignoter. Tous les trois ont des rêves, tous les trois les verront brutalement brisés.
Bâti comme un casse-tête, le polar social de l’auteure allemande Lot Vekemans dévoile un à un les éléments ayant mené aux incidents fatals de cette nuit-là, chaque personnage ayant bien sûr sa perception des événements. La pièce s’ouvre d’ailleurs avec Katalijne, catastrophée, face à une lampe multicolore éclatée en mille morceaux, qu’elle tente de recoller, qu’elle voudrait recoller, comme les morceaux de sa vie, découvre-t-on en fin de spectacle.
La scénographie de Truckstop tient dans une boîte grise, celle du relais routier. Murs, rideaux, mobilier, tout y est gris ; les vêtements des personnages semblent tristes et délavés, les fenêtres ne donnent que sur un ciel uniformément gris. La couleur a depuis longtemps déserté les lieux dans lesquels semblent errer les trois personnages décédés. L’enseigne elle-même brille d’une lueur terne, comme peinant à percer le marasme qui englue le truckstop, sorte de limbes.
Au coeur de cette boîte, le metteur en scène Arnaud Meunier dirige trois comédiens sobres et efficaces : Manon Rafaelli dans le rôle de la jeune femme qui se découvre soudain un besoin de s’émanciper, Claire Aveline, en mère à la fois intraitable et pleine d’affection, et Maurin Ollès, en Remko, qui se démarque. Son jeune camionneur plein de projets, mais qui échoue dans tout ce qu’il entreprend, est terriblement attachant. C’est par lui que la pièce aborde le délicat sujet de la mondialisation : des cochons qu’on fait voyager depuis la Russie, des poulets qu’on envoie au Japon, de toute cette marchandise qui transite, et puis de la liberté relative offerte au camionneur ou du moins, telle que Remko la perçoit.
Truckstop parle aussi du caractère implacable du commerce, de la nécessité de savoir s’adapter et des besoins des clients qui changent, eux qui ne cherchent plus qu’à manger dans un espace impersonnel, une nourriture vite avalée, vite consommée.
La coproduction de la Comédie de Saint-Étienne et de la comédie de Béthune, sous des airs de polar, propose des personnages forts et aborde des sujets qui touchent directement son jeune public.
20 NOVEMBER (Jupither Josephsson Theatre Company)

Le sujet de 20 November est tristement toujours d’actualité, alors que les tueries dans les écoles et les cas d’intimidation aux conséquences dramatiques font quotidiennement la manchette partout dans le monde.
Le 20 novembre 2006, Sebastian, un jeune de 17 ans, entrait dans son ancienne école, en Allemagne, dans le but de tuer le plus d’élèves et de professeurs possible. Avant de perpétrer son crime, l’adolescent victime d’intimidation et du rejet de ses camarades pendant des années, avait publié un texte en ligne évoquant les raisons derrière son geste. La pièce de Lars Noren s’en inspire.
« Regardez-moi ou me regardez pas. Vous serez un jour obligés de me regarder. Aujourd’hui, je vais vous montrer. » Solo au souffle puissant, 20 November touche juste à tous les coups. Avec pour seul soutien le cadre de la caméra, l’acteur David Fukamachi Regnfors maîtrise le texte comme s’il avait été écrit pour lui. Sur scène, l’acteur n’incarne pas simplement le personnage, il disparaît complètement en lui. Par sa normalité, par son raisonnement structuré, par son attitude presque toujours posée alors qu’il explique, tantôt à la caméra, tantôt au public, les raisons qui le poussent à retourner dans son ancienne école pour y tuer le plus grand nombre de gens possible, le personnage du jeune tireur est à glacer le sang. Parce que son témoignage à la caméra ne parle pas seulement de lui, il parle de ce que vivent des milliers de jeunes chaque jour, il parle de la nature humaine qui pousse à chercher constamment l’acceptation des autres, à vouloir faire partie du groupe.
Le public devient le témoin glacé, muet et passif de la longue souffrance de Sebastien pendant qu’il se faisait humilier et battre, mais demeure incapable d’empêcher le drame à venir.
« Mes actions sont simplement le résultat de votre monde, un monde qui ne me laisse pas être qui je suis. Vous avez ri de moi. C’est vous les responsables, vous. » Entouré d’une famille aimante, auprès de laquelle il tient à s’excuser plusieurs fois pour ce qu’elle aura à endurer après le geste qu’il posera, Sebastian ne se voit aucun avenir, aucune solution pour mettre un terme à la souffrance qui le ronge.
Sur scène, un grand papier kraft sert de tapis et de décor pour l’oeil de la caméra avec laquelle Sofia Jupither met en scène le discours qu’il souhaite laisser derrière lui. Non pour se justifier ou pour proclamer quelque chose, mais seulement pour expliquer les causes de toutes les morts qu’il causera, pour présenter son arsenal et démontrer son calme. Dans l’oeil de Sebastien, le vide d’une vie sans espoir et une froide résolution : à défaut d’avoir trouvé un sens à sa vie, il souhaite donner un sens à sa mort.
En une heure, 20 November nous plonge dans la détresse émotionnelle de cette jeune victime qui devient à son tour bourreau et nous montre à quel point chacun peut se sentir interpellé, voire se reconnaître dans la détresse du jeune homme. Et c’est d’autant plus troublant.
TRISTESSES (Das Fräulein kompanie)

L’île de Tristesse comptait autrefois plus de 800 résidents. Elle s’est vidée de ses habitants à la suite de la faillite de ses abattoirs. Ils ne sont plus que huit, enfin sept, car l’une d’entre eux est retrouvée pendue dans le drapeau danois, une nuit de novembre 2015. Sa découverte semble à peine surprendre les habitants, plus embêtés par la présence du cadavre que par la mort d’une des leurs. Ils attendent le retour sur l’île de Martha Heiger, fille de la pendue et chef du Parti du Réveil Populaire.
Tristesses, conçue, écrite et mise en scène par Anne-Cécile Vandalem, qui incarne aussi Martha, traite brillamment de la pression du groupe sur l’individu et de la difficulté de rester soi, de conserver ses valeurs et d’y rester fidèle face aux autres. La production s’orchestre autour de la petite communauté de Tristesses, d’un côté ce qui se dit et se montre en public et de l’autre ce qui se produit en privé, dans les maisonnettes.
L’ingénieuse mise en scène donne en effet à voir aux spectateurs ce qui se passe publiquement, au centre du village, mais aussi entre les murs des maisonnettes de carton-plâtre habitées par les personnages. Le public est ainsi témoin des conflits qui, peu à peu, passent de la sphère privée à la sphère publique. Les personnages deviennent peu à peu les acteurs d’un drame écrit pour eux, les caméramans ne se cachant même plus aux yeux du public.
L’histoire, inspirée d’un fait divers, et sa mise en scène permettent aussi d’observer l’influence du politique sur la manière de penser tout en faisant bien sûr référence à la montée des partis extrémistes ces dernières années. Le Parti du Réveil Populaire, parti d’extrême droite, s’impose comme la solution à tous les problèmes des habitants de l’île, malgré les mensonges et la manipulation. Il est la réponse à la peur et à la chape de plomb qui pèse sur leur village.
Sur Tristesse, les morts ne dorment pas en paix ; ils sont là, parmi les vivants, seulement vus par quelques-uns. Blancs, inexpressifs, ils apparaissent ici et là, se glissent dans les maisons, sur les bancs de l’église, traversent la scène, le pas traînant, habitent l’île de leur musique. La voix de la soprano Françoise Vanhecke, le fantôme d’Ida Heiger, est particulièrement belle.
Toute la production baigne dans une étrange atmosphère, glauque bien sûr, mais aussi franchement inquiétante, où le public peut percevoir le lent étouffement des personnages. Mais la pièce est drôle malgré tout, surtout grâce au personnage du maire, Soren Peterson, détestable avec tout le monde sauf sa chef de parti. Toute la distribution offre d’ailleurs une prestation impeccable.
La comédie noire de la Belge Anne-Cécile Vandalem saisit d’effroi du début à la fin, car ce n’est pas parce qu’on rit que c’est drôle…