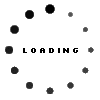La fin de la fiction : essai réussi

La fin de la fiction : essai réussi
En collaboration avec Théâtre Catapulte d’Ottawa, la compagnie Nuages en pantalon invite le public à une foisonnante réflexion sur notre réalité collective en se plongeant dans les interstices de sa « genèse ». Tels un essai ou un documentaire en condensé, le projet La fin de la fiction nous propulse de l’invention de l’imprimerie de masse aux plus récentes innovations de l’Internet, en passant par Buffalo Bill, Disney, Timothy Leary et Steve Jobs.
En sept épisodes et un épilogue, la pièce présentée ces jours-ci au Périscope est une savante mise en abîme, une fiction scénique qui aborde la fiction à grande échelle. Chaque chapitre aborde un thème précis choisi consciencieusement par l’équipe de création, passant de l’imprimerie au rêve américain, du XIXe siècle à Disneyland jusqu’aux avancées technologiques des 60 dernières années, pour décortiquer de manière ludique le façonnement de notre réalité d’aujourd’hui, ses aboutissements comme ses aberrations. Si la proposition de 2h50 avec entracte peut parfois sembler dense et complexe, elle s’avère aussi rigoureuse, documentée, audacieuse que drôle, décalée et hyper accessible. Au travers des chapitres, le public découvre une multitude de personnages anonymes ou (re)connus, qui viennent présenter des concepts parfois notoires, parfois nébuleux, au travers de « sketchs documentaires » où l’anachronisme est roi, au grand plaisir des spectateurs.
Tout commence d’ailleurs au coin d’un feu, il y a 45 000 ans, où une tribu échange quelques histoires de chasse ; un clin d’œil somme toute assumé à Kubrick et à sa fable cinématographique 2001 l’odyssée de l’espace qui rencontrerait l’allégorie de la caverne de Platon. Un énorme cube vide, dont une seule face est fermée servant d’écran, meuble une scène relativement nue. La simplicité de la scénographie lui procure une superbe malléabilité qui vient appuyer le récit, et ce, en toute circonstance, répondant aux exigences de chaque scène. Les nombreux costumes viennent pallier la sobriété du décor, plaçant les personnages dans leurs époques respectives tout en ajoutant un brin de folie ici et là.
Pour la première moitié de la représentation, deux penseurs contemporains semblent avoir particulièrement guidé les concepteurs du spectacle, jusqu’à leur octroyer le rôle de passeurs-animateurs. D’abord, Elizabeth Eisenstein, décédée en 2016, autrice de The Printing Press As An Agent of Change (1979) et championne de tennis, ouvre le premier chapitre et met en contexte les changements majeurs imposés par l’invention de l’imprimerie aux caractères amovibles. Dans son livre, elle propose trois mouvements majeurs qui bouleverseront les vies d’alors et de maintenant : la renaissance, la réforme et la révolution scientifique. Trois concepts qui deviendront les assises de La fin de la fiction. Puis, en « direct » de sa cabine de diffusion radiophonique, apparaît le célèbre écrivain et animateur Kurt Andersen (auteur de Fantasyland: How America Went Haywire: A 500-Year History (2017)), narrant la suite des choses. Par la mise en scène de sa présence, la troupe aborde l’Amérique rêvée, fantasmée, puis corrompue entre autres pour des raisons pécuniaires.
Dès le départ, plusieurs moments se gravent dans nos mémoires et touchent la cible : mentionnons ce jeune étudiant médiéval, qui, dans la forme du « stand up » ou « open mic », nous raconte son parcours périlleux sur les routes de France du 14e siècle pour trouver le seul exemplaire d’un livre qu’il doit consulter, ou ce numéro magnifiquement mélodieux et hilarant de religieux qui, par l’entremise de chants grégoriens en « latin », aux paroles traduites sur écran, échangent leurs doutes sur certains dogmes de l’église auxquels ils ne croient pas vraiment. Ou, encore, le remue-méninge de l’équipe de marketing de l’Anglais Richard Hakhuyt, qui « inventa » à l’époque la « campagne publicitaire » vendant une Amérique plus belle que vraie aux Européens ; une campagne qui inspirera probablement les puritains (grandiose Olivier Normand dans le rôle de l’un d’eux), ce groupuscule religieux qui trouvera sur les berges de la Virginie un « paradis terrestre ». L’anachronique talk-show C’est le XIXe! vient « conclure » le volet historique en nous présentant des figures importantes de la création du show-business et du mot « entrepreneur », dont PT Burnam et Buffalo Bill, qui cimenteront dans l’imaginaire collectif une vision faussée, entre autres, de l’Ouest et des Amérindiens.
La deuxième partie bifurque légèrement de l’histoire remaniée pour toucher adroitement aux fantasmes de l’Amérique, essentiellement au « American way of life » commercialisé par Disney. Alors qu’un couple idyllique des années 50 et ses enfants dégustent à table un macaroni au fromage, le père s’extasie devant sa nouvelle voiture. Pourtant, Alice, l’aînée, s’éveille doucement de ce rêve presque cauchemardesque grâce à sa voisine (John Doucet) qui lui inculque le principe de « frontières du réel », s’approchant des principes du miroir abordés dans Alice au pays des merveilles ou même dans le film La Matrice. Les plus attentifs remarqueront d’ailleurs le titre du livre que cette voisine a en main : Amusing Ourselves to Death de Neil Postman, toujours en écho à la pièce.
Puis, le psychédélique prend la relève, alors qu’un certain Douglas (possiblement Engelbart, inventeur de la souris) fait de l’autostop et rencontre par hasard le gourou du LSD, Timothy Leary. L’informatique et la contre-culture s’entrechoquent : c’est la révolution numérique. De Jobs à Zuckerberg face à un congrès américain des plus carrolliens, de 1984 à Google en passant par les algorithmes de YouTube, La fin de la fiction saute à pieds joints dans ce qui a façonné le monde d’aujourd’hui. L’équipe de création a la brillante idée d’utiliser quelques tours de magie surannés (la femme sciée en deux, la disparition derrière un drap), mais toujours efficaces, pour tenter d’expliquer « la grande illusion du choix ». La scène où les comédiens décortiquent, grâce à un truc de micromagie le fonctionnement de Google depuis sa création, monétisant les recherches grâce aux Adword et Adsense, est à elle seule un véritable tour de force de limpidité. Des cookies qui aspirent nos données aux formules mathématiques de prédiction de comportement, ou encore au capitalisme de surveillance, cette portion du spectacle peut s’avérer aussi fascinante que terrorisante.
Menée avec brio (parce que le fil d’Ariane aurait pu casser à de multiples reprises) par Jean-Philippe Joubert, avec la collaboration de Marie-Hélène Lalande et de Caroline Martin, La fin de la fiction s’avère une courtepointe exploratoire aux multiples modes narratifs. Elle propose un heureux mélange des genres, allant de la caricature au contextuel en passant par l’intime et une certaine dose d’absurde, le tout toujours au service du récit. Un récit d’ailleurs qui se termine avec une réorientation vers la notion de notre existence et notre « droit au sanctuaire », grâce à une scène de discussion tout en simplicité entre Olivier Normand et Carolanne Foucher. Et malgré ce qu’indique le titre, notre propension au(x) récit(s), croyances et autres conspirations nous éloignent, encore trop, de la fin de la fiction…
Crédit photo : NEP
[tribe_event_inline id= »18908″]
Calendrier
{title:linked}
{thumbnail}
Du 22 mars au 9 avril 2022
{venue:linked}
{excerpt}
[/tribe_event_inline]